Mettre à la portée du plus grand nombre les connaissances les
plus diverses, depuis leurs bases jusque dans leurs développements les plus complexes, cela s’appelle "vulgariser"; c’est une démarche qui se généralise et se répand, que ce soit à travers les
livres, les émissions télévisées, ou les informations diffusées sur la Toile; l’on ne compte plus les séries documentaires ou pédagogiques prétendant initier "les nuls" à des domaines allant de
l’astrophysique au jardinage bio en passant par l’holmésologie, tel ou tel idiome parlé aujourd’hui dans le monde ou ayant été parlé jadis… et mille autres spécialités justement hyperspécialisées
que l’on ne désespère pas de rendre accessible au premier profane venu.
N’ayant pas de culture générale particulièrement étendue, n’étant par ailleurs spécialiste de rien, je suis néanmoins curieuse, et
dotée d’une belle appétence pour la découverte, pour l’assimilation de savoirs nouveaux. Je suis donc fort aise de pouvoir accéder aussi facilement à ces œuvres de vulgarisation, dont
quelques-unes m’ont donné ce sentiment merveilleux de comprendre, comme autant d’évidences, des choses pour moi difficiles dont j’ignorais tout auparavant. J’en déduisais aussitôt que le travail
de "mise à portée" avait été correctement mené – sans songer qu’aux yeux des initiés ces textes ou ces émissions que je jugeais remarquables étaient sans doute truffés de lacunes, voire
d’inexactitudes.
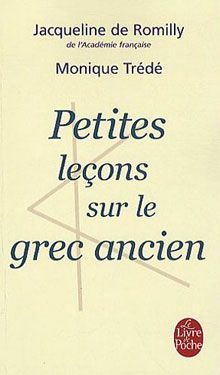 Tout cela pour dire que
je n’ai pas la moindre prévention quant à la vulgarisation et que j’estime éminemment précieux de pouvoir s’informer sur à peu près tout selon son désir. Mais la vulgarisation devient gênante
quand, pour aboutir à une accessibilité maximale, on consent à des approximations douteuses, à des simplifications excessives ou, pire, à des inexactitudes. Je ne me permettrai pas d’écrire que
ces défauts gâtent le livre que je souhaite évoquer: je l’ai acheté justement parce que je suis ignare en sa matière – le grec ancien, que je n’ai pas étudié à l’école alors que je l’aurais pu,
et que j’ai persisté à négliger plus tard, bien que disponible et mûre intellectuellement pour l’aborder. Pourtant, j’ai eu très vite le sentiment vague mais tenace que quelque chose ne
fonctionnait pas dans ces Petites leçons sur le grec ancien, mince Livre de Poche d’environ 150 pages dont s’était emparée ma main errant sur l’étal d’un libraire tandis qu’elle
explorait sans chercher. Je l’avais saisi sur la foi du nom prestigieux tracé sur la couverture, Jacqueline de Romilly – au côté d’un autre, Monique Trédé, que je ne connaissais pas. La lecture
de la quatrième de couverture prolongea mon geste, qui se trouva affermi par ces quelques mots de l’avant-propos: C’est des qualités exceptionnelles de
cette langue qu’il sera ici question, non pour en enseigner les formes et les règles mais pour en dire les beautés. Une intention perçue comme une gageure… et qui acheva de m’inciter
à acheter le livre.
Tout cela pour dire que
je n’ai pas la moindre prévention quant à la vulgarisation et que j’estime éminemment précieux de pouvoir s’informer sur à peu près tout selon son désir. Mais la vulgarisation devient gênante
quand, pour aboutir à une accessibilité maximale, on consent à des approximations douteuses, à des simplifications excessives ou, pire, à des inexactitudes. Je ne me permettrai pas d’écrire que
ces défauts gâtent le livre que je souhaite évoquer: je l’ai acheté justement parce que je suis ignare en sa matière – le grec ancien, que je n’ai pas étudié à l’école alors que je l’aurais pu,
et que j’ai persisté à négliger plus tard, bien que disponible et mûre intellectuellement pour l’aborder. Pourtant, j’ai eu très vite le sentiment vague mais tenace que quelque chose ne
fonctionnait pas dans ces Petites leçons sur le grec ancien, mince Livre de Poche d’environ 150 pages dont s’était emparée ma main errant sur l’étal d’un libraire tandis qu’elle
explorait sans chercher. Je l’avais saisi sur la foi du nom prestigieux tracé sur la couverture, Jacqueline de Romilly – au côté d’un autre, Monique Trédé, que je ne connaissais pas. La lecture
de la quatrième de couverture prolongea mon geste, qui se trouva affermi par ces quelques mots de l’avant-propos: C’est des qualités exceptionnelles de
cette langue qu’il sera ici question, non pour en enseigner les formes et les règles mais pour en dire les beautés. Une intention perçue comme une gageure… et qui acheva de m’inciter
à acheter le livre.
La déception fut au rendez-vous et je n’ai pas dépassé la
quatrième de ces huit petites leçons. Un malaise s’était installé, d’autant plus pesant que je ne parvenais pas à localiser ce qui me troublait et m’indisposait. C’était une sensation
constante que l'on énonçait les choses comme si l’on sautait des haies, que des articulations essentielles manquaient, que des portes ouvertes étaient enfoncées… et j’ai fini par interrompre ma
lecture. Maintenant, avec le recul, j’identifie deux ou trois de ces pierres sur lesquelles j’ai buté. Par exemple cette affirmation figurant page 25, dans le premier chapitre intitulé "L’étrange
vitalité d’une langue morte": Aujourd’hui bien des œuvres de notre littérature s’inspirent de la Grèce. La Grèce, ses mythes, ses héros, sont encore à la
mode… Bizarre formulation: comment des éléments fondateurs, consubstantiels à notre terreau culturel –
ce que sont, je crois, ces mythes et héros – pourraient-ils être (ou ne pas être) "à la mode", c’est-à-dire soumis aux caprices d’un
engouement ou d’une désaffection passagère et superficielle? Ils sont en nous et forment notre sensibilité, fût-ce à notre insu. En revanche, la façon dont on ranime – ou enterre – à telle ou
telle époque mythes, héros, artistes du passé peut bien en effet relever de la "mode". Ou de diktats idéologiques...
Une autre étrangeté dans ce livre censé faire aimer les beautés
du grec ancien m’a gênée: je ne vois nulle part reproduit l’alphabet qui sert à le transcrire, et tous les mots grecs sont écrits en caractères latins. N’est-ce pas les trahir, et les offrir sous
une forme bâtarde qui n’est pas celle d’origine et qui n’est pas encore une traduction? Prétendrait-on pareillement faire aimer le chinois sans en montrer un seul idéogramme? Que l'on transcrive
en alphabet latin pour une meilleure compréhension, je veux bien puisque justement le livre est destiné aux non-hellénistes. Mais pourquoi n'avoir pas systématiquement indiqué la graphie
d'origine à côté de la transcription? Etait-ce trop compliqué sur un plan technique? Si tel est le cas, l’on aurait alors dû le préciser, et au moins proposer un tableau des caractères grecs pour
que le lecteur ait présente à l’œil cette géométrie scripturale si particulière.
Quant aux développements touchant à la syntaxe, à la morphologie, là encore j’ai été gênée… Notamment de ce que les auteurs, quand il
est question de généalogie linguistique, se réfèrent à l’indo-européen comme à n’importe quelle autre langue attestée – per exemple en écrivant des huit cas de
l’indo-européen, le grec n’en a conservé que cinq (p. 45) – alors qu’il s’agit d’une langue entièrement hypothétique, reconstruite très partiellement qui plus est sur la base des
multiples parentés repérées entre plusieurs langues parlées ou ayant été parlées dans une aire géographique allant des rives de l’Atlantique et de la Baltique jusqu’aux confins de l’Inde. Le grec
fait en effet partie, comme le sanskrit, le persan, les langues slaves, germaniques, romanes… d’un vaste ensemble appelé "indo-européen commun" ou, parfois, "proto-indo-européen", dont rien à ce
jour ne prouve l’existence: l'on n'a encore découvert aucune trace matérielle de ce "proto-idiome", aucun témoignage écrit – et pour cause puisque, s’il a jamais été parlé, il l’aura été aux
temps préhistoriques soit… avant que l’homme invente l’écriture. On suppose qu’il a été parlé simplement parce qu’il y a des indices dans des langues attestées d’un probable "ancêtre
commun". Or ce statut hypothétique n'est jamais spécifié; le terme "indo-européen", tantôt adjectif, tantôt substantif, renvoie aussi bien à la famille de langues, tout à fait concrète, qu'à
l'idiome théorique – la confusion est de taille.
D’autres formulations m’ont dérangée, à propos des procédés de
formation de mots nouveaux par exemple, mais je n’arrive toujours pas à cerner où, et pourquoi, naît le malaise… En tout cas, je ne recommanderai certainement pas cet ouvrage pour stimuler chez
un profane un quelconque attrait pour le grec ancien.
En ce qui me concerne, je me souviens d’avoir senti se lever en moi un tel attrait – que je n’ai pas prolongé par l’étude, fainéantise
oblige – en écoutant les comédiens de la compagnie Demodocos* dire un chant de l’Odyssée en alternant des passages en français et des passages en grec ancien. Ils énonçaient les vers en
respectant les scansions, la mesure des syllabes, et s’accompagnaient d’instruments touaregs – proches, dit-on, des instruments en usage dans la Grèce antique. Ils mimaient un peu – pas tant que
cela… Et moi, je comprenais tout ce que je voyais et entendais alors même que je ne connaissais pas un traitre mot de la langue d’Homère. La compréhension se situait à un niveau non intellectuel,
en deçà de l’entendement – c’était magique et je les aurais volontiers écoutés dire ainsi l’Odyssée tout entière…
Jacqueline de Romilly & Monique Trédé, Petites leçons sur le grec ancien, Le Livre de Poche,
janvier 2010, 160 p. – 5,50 €.
* La compagnie Demodocos, sous la direction de Philippe Brunet,
maintient vivants le théâtre, la poésie, le chant antiques à travers de nombreux spectacles. Elle est à l’origine des Dyonisies, un festival intimiste et chaleureux organisé chaque année à Paris,
au couvent des Cordeliers, à la charnière des mois de mars et d’avril.

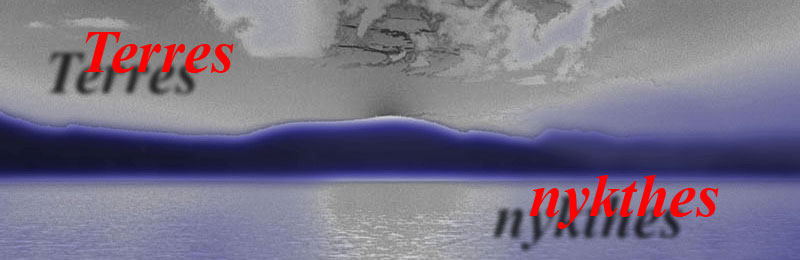




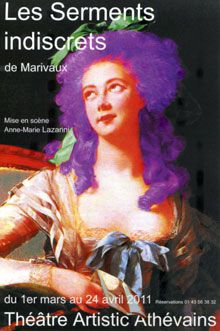
 L'
L'
 M
M
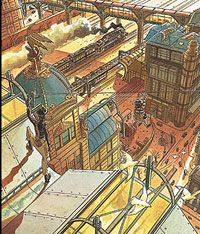

 D’
D’ P
P


/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)