Il y a toujours, entre le vécu d’un écrivain et le contenu de son œuvre – fût-elle ouvertement autobiographique – un écart creusé par le travail d’écriture. Un écart plus ou moins grand, que beaucoup d’auteurs ne cherchent guère à mesurer. D’autres en revanche, quelque difficulté qu’ils aient d’abord à parler de manière analytique du dernier livre qu’ils ont écrit, s’efforcent de cerner la distance qui sépare leur expérience de leur texte. François Emmanuel est de ceux-là qui, sollicités, tâchent de décrypter à l’intention des esprits curieux leur façon d’écrire. Ce décryptage a été l’objet de quatre conférences qu’il a prononcées en 2007 à la chaire de poétique de la Faculté de philosophie et lettres de l’université catholique de Louvain, publiées ensuite aux éditions Lansman sous le titre Les Voix et les ombres.
Parmi les divers aspects de la genèse de ses livres, il aborde au cours de la dernière de ces conférences la question des rapports que nouent dans [sa] propre existence le roman et la psychothérapie – question qui lui a maintes fois été posée puisque, écrivain, il est également psychothérapeute et qu’il a souvent convoqué dans ses œuvres les figures de la folie ou du trouble mental. Après avoir posé clairement ce qu’exige de lui d’une part le roman, et d’autre part la séance de thérapie, il peut ainsi répondre que ce sont des activités profondément différentes. […] qui ne communiquent qu’au travers de filtres tellement distinctifs qu’il n’est pas faux d’affirmer qu’elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre – si même elles peuvent parfois offrir l’une à l’autre une résonance.
Patients et lecteurs ne rencontrent donc pas la même personne. Les seconds, à moins de compter aussi au
nombre des patients, ne connaîtront jamais de François Emmanuel, à travers lectures et rencontres, que son "être littéraire". Une connaissance qui, pour moi, tient encore de l’approche – je suis
loin d’avoir lu tous ses livres.
Je me souviens de ma toute première découverte, Le Vent dans la maison… J’ai très vite aimé, avant d’être subjuguée, ses phrases peu narratives qui enlacent, coulent, louvoient et
s’étirent en longues énumérations où les mots se juxtaposent sur plusieurs lignes tandis qu’ailleurs elles se réduiront à un seul mot et se plairont aux élisions. Phrases-rythme, phrases-souffle
qui portent le sens comme le vent les oiseaux, négligeant souvent les trop fortes articulations logiques de la langue au profit de sa musicalité.
Elles respirent. Souffle et vie – âme.
Nous nous sommes rencontrés
quelquefois – pour une interview, à titre amical autour d’un café, dans le cadre de soirées-lecture – et à chaque fois je retirais de ces moments d’échange des impressions profondes,
indéfinissables cependant, analogues à celles que me laissaient en alluvions ses textes. Ces impressions ont fini par cristalliser en ces quelques notes filées, frêles tentatives essayant de
mettre en mots ce que je crois percevoir de "l’être littéraire" de François Emmanuel…
Autant sa poignée de main est ferme, et d’une franchise rayonnante son sourire, autant sa voix, un peu grenue, est douce, pastel et sablonneuse. Son débit posé et sans accident, qui marque peu
les intonations – s’infléchissant à peine aux points finaux, ne se relevant guère plus aux points d’interrogations – rappelle celui d’un fleuve aux flancs larges dont le cours tranquille et
puissant charrie sans troubles les navires. C’est une voix qui pousse les mots sans heurts et sans bruit – étale.
Il arrive qu’une phrase s‘interrompe en cours d’énonciation. Un silence suit qui se prolonge en une infinité de points de suspension et la voix comme la pensée paraissent s’absenter tandis que
les yeux se détournent, au loin, vers un horizon qu’il est le seul à apercevoir. Puis il reprend le fil de la conversation, revient au monde comme rappelé par un gong. Souvent au détour des mots
il rit – et rien n’est émouvant comme ces rires effleurés, pastels eux aussi. Mais à aucun moment ces retraits et silences, ces coups d’estompe sur certains mots n’affectent le sens ni la clarté
des propos – rien ne demeure abscons d’une argumentation ou d’une explication; tout s’entend parfaitement, et même, en creux dans ces "absences" justement, résonnent ces infimes suppléments
signifiants qu’éteignent les discours trop explicatifs, trop pédagogiques. Sa parole est similaire à son écriture: rythme et respiration y sont pareillement importants. À condition de savoir
tendre l’oreille – et l’ouïe de l’œil quand on le lit.
Par sa voix autant que par son regard, ses gestes ou ses postures, François Emmanuel a la présence
poète, à la fois évanescente et dense, insaisissable et prégnante.
Il est poète.
Je ne vois pas comment dire autrement ce que j’ai perçu de son "être littéraire".


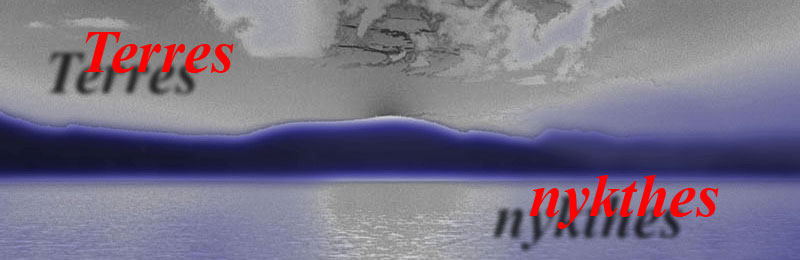


 L
L
 L
L
 J
J/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)