 Lorsqu’à l’approche d’un événement annuel, tel le Festival des jeux du théâtre de Sarlat, on regarde les mois écoulés depuis la précédente édition, on a
l’impression très nette que le temps s’est contracté, que les jours et les semaines se sont ramassés au creux d’un minuscule mouchoir de poche et qu’en un pas de rien du tout le souvenir les
franchit allègrement, mêlant en une figure aplanie, comme dépourvue de profondeur, tout ce qui reste au fond de soi d’impressions, de joies et de déceptions – car il en survient quelquefois…
Tandis qu'en moi sont encore vives les empreintes du 60e festival le 61e est imminent: les dates
sont arrêtées depuis longtemps – il se déroulera du jeudi 19 juillet au samedi 4 août – et le programme, rendu public lors de la conférence de presse du 16 avril dernier,
est consultable ici, chaque spectacle accompagné, comme toujours, par une notice
descriptive brève mais suffisante pour informer les spectateurs potentiels. La billetterie sera ouverte à partir du lundi 2 juillet.
Lorsqu’à l’approche d’un événement annuel, tel le Festival des jeux du théâtre de Sarlat, on regarde les mois écoulés depuis la précédente édition, on a
l’impression très nette que le temps s’est contracté, que les jours et les semaines se sont ramassés au creux d’un minuscule mouchoir de poche et qu’en un pas de rien du tout le souvenir les
franchit allègrement, mêlant en une figure aplanie, comme dépourvue de profondeur, tout ce qui reste au fond de soi d’impressions, de joies et de déceptions – car il en survient quelquefois…
Tandis qu'en moi sont encore vives les empreintes du 60e festival le 61e est imminent: les dates
sont arrêtées depuis longtemps – il se déroulera du jeudi 19 juillet au samedi 4 août – et le programme, rendu public lors de la conférence de presse du 16 avril dernier,
est consultable ici, chaque spectacle accompagné, comme toujours, par une notice
descriptive brève mais suffisante pour informer les spectateurs potentiels. La billetterie sera ouverte à partir du lundi 2 juillet.
Le dossier de presse m'a d'ores et déjà permis d'établir une petite sélection de spectacles qui, de prime abord, m’attirent, sachant bien par ailleurs que j'en verrai très certainement d'autres,
entraînée vers eux par l’"effet Plamon". Cependant, un dossier, aussi bien conçu soit-il, ne remplace pas une
conférence de presse ni, a fortiori, une rencontre
avec l’une ou l’autre personne qui exposera de vive voix et dans l’éphémère flamme de la conversation la teneur d’un programme.
Absente de la conférence sarladaise je me suis donc tournée, comme à plusieurs reprises déjà, vers le directeur artistique du festival Jean-Paul Tribout. Très occupé et soumis à
un emploi du temps lui laissant assez peu de liberté, il m’a tout de même accordé, avec sa gentillesse et sa chaleur coutumières, une longue entrevue dont je livre ici une transcription qu’il a
relue avant publication.
Changements
À première vue rien ne semble avoir changé. Mais à scruter
plus attentivement le petit dépliant rectangulaire mis à la disposition du public on constate que le prix des places a légèrement augmenté – de deux euros par tranche tarifaire – et que dix-huit
spectacles sont programmés quand, depuis plusieurs années, plus de vingt étaient proposés. Le budget du festival a, paraît-il, été diminué d’environ 30%. Est-ce le contrecoup d’éventuelles
largesses qui auraient été consenties pour fêter l’an dernier le soixantième anniversaire?
"En aucun cas", explique Jean-Paul Tribout:
Cet anniversaire n’a donné lieu à aucune augmentation significative des subventions et, en tout cas, la baisse des
soutiens financiers intervenue cette année n’a aucun rapport avec lui. Simplement nous sommes en période de "crise" et le financement du festival en a subi les conséquences. Et puis certains de
nos partenaires qui nous accompagnent depuis très longtemps ont souhaité faire une pause; on sait bien que, dans le domaine du subventionnement, soutenir sur le long terme un événement récurrent
comme ce festival interdit de s’ouvrir à de nouvelles manifestations. C’est pourquoi certains partenaires institutionnels décident d’allouer leurs subsides à d’autres événements, pour faire
tourner un petit peu les choses. Il y a aussi la question des volontés politiques qui intervient… De plus en plus le ministère de la Culture se décharge sur les collectivités locales – ce sont
elles qui, en France, financent à peu près 70% de la création culturelle. Et les collectivités locales, en période de crise, deviennent frileuses… De plus, en ce qui concerne Sarlat, une
institution comme la D.R.A.C., qui a déjà baissé de façon drastique ses subventions, est davantage encline à soutenir des structures qui fonctionnent à l’année sur le territoire régional qu’un
festival qui certes revient tous les ans mais qui ne dure que trois semaines… Et comme le festival tourne gentiment, qu’il fait littéralement partie du paysage, on a tendance à oublier que son
organisation demande des efforts et qu’il lui faut un soutien. Maintenant, il faut espérer que ces pauses ne seront que temporaires… Cette année, notre tâche a donc été un peu plus compliquée:
30% d’argent en moins, c’est considérable, surtout pour un festival qui, en regard d’autres événements du même genre, bénéficie d’un budget modeste – je ne parle pas de celui d’Avignon: il est
"hors concours", si l’on peut dire… Il y a des frais constants sur lesquels il est impossible de rogner – le coût des assurances, l’entretien des gradins, etc. donc il n’y a pas trente-six
solutions: il a fallu raccourcir un peu la durée du festival, et augmenter le prix des places. Cependant, malgré ce budget serré, nous avons tout de même réussi à inviter dix-huit spectacles,
majoritairement de qualité et qui, je crois, satisferont de nombreux publics. Et puis ces restrictions ont eu un avantage: le comité du festival s’est montré moins demandeur de vedettes
(rires)…
Après ces explications, voyons donc la "carte" qu’a préparée le directeur artistique qui, une fois de plus, démontre son (grand) art de composer avec les multiples critères dont il doit tenir
compte quand il envisage d'intégrer tel ou tel spectacle à l'affiche de l'année…
PROGRAMME
Jeudi 19 juillet. Jardin des Enfeus, 21h45.
Zadig, de Voltaire. Mise en scène et adaptation de Gwenhaël de Gouvello.
Compagnie du Catogan.
J.-P. Tribout: On ne joue quasiment plus le théâtre
de Voltaire qui, il faut bien le dire, est assez indigeste. Alors qu’il espérait bien être un grand auteur de théâtre… En revanche ses contes – Candide bien sûr, Zadig,
Micromegas… incitent à l’adaptation scénique. Celle qu’a réalisée Gwenhaël de Gouvello – un jeune metteur en scène qui n’est jamais venu à Sarlat – est festive et joyeuse, ce qui est je
crois un atout pour ouvrir le festival. Son travail est aussi très représentatif de cet art de "faire du théâtre avec peu de choses"; il a traité le texte de Voltaire d’une façon qui évoque la
bande dessinée – ce sont "les aventures de Zadig" comme il y a "les aventures de Tintin" – et sa mise en scène est servie par une belle équipe d’acteurs.
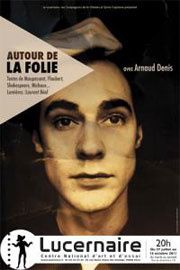 Vendredi 20 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures.
Vendredi 20 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures.
Autour de la folie, conception, mise en scène et interprétation d’Arnaud Denis, à partir de textes de Maupassant, Flaubert, Michaux, Shakespeare,
Karl Valentin, etc.
Compagnie des Compagnons de la chimère.
J.-P.
Tribout: Voilà un très beau spectacle, monté par un jeune homme extrêmement brillant, que nous avions vu en 2007 à
Sarlat incarner Scapin, dans les Fourberies du même nom dont il avait aussi signé la mise en scène. Il est également l’auteur d’une pièce sur les procès de Nuremberg – Nuremberg, la
fin de Goering – dont il a assuré la mise en scène et qui est passionnante mais qui, hélas, n’a pas marché du tout. Je suis très étonné qu’un jeune homme de son âge s’intéresse à cette
période de l’histoire, aux suites de la Seconde Guerre mondiale… Sa pièce est écrite et montée de façon très intelligente; mais à mon sens, le spectacle n’était pas totalement abouti. Arnaud est
en tout cas très doué, plein de talent, et ce spectacle "autour de la folie" qu’il a conçu, monté, qu’il interprète seul en scène le démontre bien. Il ne sera peut-être pas tout à fait adapté au
plein air, parce que la mise en scène joue beaucoup sur les contrastes entre ombre et lumière, sur la silhouette qu’on distingue dans la pénombre – et la nuit ne sera pas encore totale quand il
jouera mais je suis sûr que la qualité de son interprétation palliera cet inconvénient.
Samedi 21 juillet. Jardin des Enfeus, 21h45.
La Pitié dangereuse, de Stefan Zweig. Adaptation et mise en scène : Stéphane Olivié Bisson.
Compagnie Carinae.
J.-P. Tribout: Voilà, après Zadig, encore un texte non
théâtral adapté pour la scène… La Pitié dangereuse est le premier roman de Zweig; il n’est pas très connu. Je trouve que Stéphane Olivié Bisson, qui est aussi comédien, l’a très bien
monté – il s’était signalé l’an dernier par sa mise en scène du Caligula de Camus, au théâtre de l’Athénée, avec Bruno Putzulu. J’ai découvert ce spectacle à Avignon et j’ai apprécié la
qualité d’interprétation, l’ambiance scénique, qui évoque le baroque viennois, avec une musique très présente, et puis le sujet: le roman raconte l’histoire d’une jeune fille paralysée, de son
rapport à l’amour…
NB - Le spectacle est repris en ce moment au théâtre du Lucernaire. Les représentations sont programmées jusqu’au 30 septembre, à 21h30; l’équipe devra donc faire relâche
pour venir à Sarlat, ainsi que le montre la page de la
pièce…
 Dimanche 22 juillet. Abbaye Sainte-Claire: Journée des auteurs.
Dimanche 22 juillet. Abbaye Sainte-Claire: Journée des auteurs.
Jusqu’à présent, j’avais eu l’habitude de voir cette journée un peu spéciale dédiée aux auteurs contemporains – le public peut assister à deux spectacles et profiter d’un repas pour le prix d’un
seul billet – figurer en fin de festival. Cette année elle fait presque l’ouverture; mais il n’y avait pas d’autre possibilité que le 22 juillet pour organiser cette "journée" qui ne peut avoir
lieu qu’un dimanche: la durée un peu écourtée du festival a réduit à deux le nombre de dimanches festivaliers, et le second tombe le 30 juillet, soit une de ces dates qui, faisant charnière entre
les deux mois estivaux, sont des sortes de no man’s land touristiques revenant à vider les gradins – les juillettistes étant sur le départ quand les aoûtiens sont, eux, pris dans les bouchons
sinon en train de boucler les valises. Un autre changement est à signaler: la S.A.C.D. qui depuis de nombreuses années parrainait cette "journée", a retiré son soutien. C’est une pause, dont rien
ne dit qu’elle sera provisoire mais qui n’a pas empêché le maintien de ce moment particulier du festival:
J.-P.
Tribout: Nous avons malgré tout voulu continuer à aider les auteurs contemporains; nous avons donc choisi de conserver
intacte la formule mais au lieu d’être une "Journée S.A.C.D." ce sera simplement une "Journée des auteurs."
18 heures
Lecture de la pièce de Michèle Laurence Le Jeune Homme à la canne. Par Élodie Menant,
Isabelle Gazonnois, Michèle Laurence et Pierre Cachia.
J.-P. Tribout: Michèle Laurence est à la foi comédienne et auteur; je la connais bien, j’ai vu plusieurs de ses pièces et, dans celle-ci, elle a fait un très joli
travail autour du roman de Radiguet, Le Diable au corps. Elle a imaginé une comédienne qui doit jouer dans une adaptation théâtrale de ce roman et qui se concentre dans sa loge; au fur
et à mesure des personnages du Diable au corps surgissent, c’est-à-dire Marthe, l’inspiratrice de Marthe, Alice et, bien sûr, Radiguet lui-même. Il y a donc une réflexion sur les
rapports entre une femme et un homme plus jeune qu’elle, un questionnement sur le scandale qu’a suscité le roman à l’époque de sa parution – le scandale tient-il à cette relation entre une femme
et un homme plus jeune, ou bien au fait que cette femme a entretenu une liaison amoureuse pendant que son fiancé était au front? À cela s’ajoute une réflexion sur la création, à la fois
littéraire, à travers Radiguet qui s’inspire d’une femme réelle pour créer son héroïne de roman, et théâtrale par le truchement de cette comédienne qui réfléchit à son rôle. Le texte est très
intéressant, mais peut-être difficile à finaliser dans une mise en scène aboutie…
19h30
Pause repas: l’ "Assiette périgourdine".
21 heures
Dans la solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès.
Mise en scène de Patrick Roldez.
Compagnie Le Théâtre de l'eau qui dort.
J.-P.
Tribout: Bernard-Marie Koltès est, avec Jean-Luc Lagarce, un des grands auteurs français contemporains. Dans la
solitude des champs de coton a été très souvent monté, notamment par Patrice Chéreau. Ici, c’est le "régional de l’étape" qui assure la mise en scène – Patrick Roldez est en effet sarladais.
L’obscurité a une grande importance dans ce spectacle, qui risque donc de pâtir un peu des conditions du plein air puisque, programmé à 21 heures, il ne bénéficiera pas de la nuit close. Mais
Patrick a accepté de courir le risque. Et puis l’argument reste fort de toute façon: il s’agit des rapports entre un dealer et son client. C’est bien joué, bien mis en scène, et je pense qu’avec
ces deux dramaturges contemporains, l’un décédé l’autre bien vivant, nous aurons une belle "Journée des auteurs".
Lundi 23 juillet. Jardin des Enfeus, 21h45.
Homme et galant homme, d’Eduardo De Filippo. Mise en scène de Patrick Pelloquet.
J.-P. Tribout: L’on avait déjà vu une pièce de cet auteur
italien à Sarlat, il y a une dizaine d’années. Ce texte-là, qui est très amusant, est mis en scène par un habitué du festival – la dernière fois qu’il est venu, en 2010, il avait présenté La
Gonfle, un texte méconnu de Roger Martin du Gard vraiment exceptionnel au niveau de la langue – qui dirige actuellement le Théâtre national des Pays de Loire. Je n’ai pas vu ce spectacle,
mais je connais le texte, je connais le travail de Patrick Pelloquet, et j’ai une grande confiance dans ce qu’il va nous proposer.
Mardi 24 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures.
Love letters, de A.R. Gurney (adaptation française d’Anne Tognetti et Claude Baignères).
Mise en scène et interprétation: Isa Mercure et Gilles Guillot.
Théâtre du Barouf
J.-P. Tribout: C’est une œuvre très connue, qui a été très souvent montée, avec notamment pour interprètes Anouck Aimée et Philippe Noiret. Il s’agit de deux
Américains qui relisent les lettres qu’ils se sont envoyées tout au long de leur vie, depuis l’école primaire. Cet homme et cette femme ont mené leur vie chacun de leur côté, et à travers cet
échange épistolaire, c’est à la fois l’histoire d’un amour non réalisé qui se dévoile et un portrait de l’Amérique contemporaine qui se dessine. D’un point de vue scénographique, c’est
extrêmement sobre, à la limite de la lecture – c’est d’un statisme total mais ça fonctionne admirablement.
Mercredi 25 juillet. Place de la Liberté, 21h30.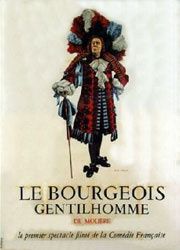
Le Bourgeois gentilhomme, de Molière. Mise en scène de Laurent
Serrano.
J.-P. Tribout: À Paris, on a pu voir cet hiver, presque simultanément, trois mises en scène de cette pièce; Denis
Podalydès a aussi choisi de la monter – les représentations viennent de commencer à Fourvière et le spectacle est, paraît-il, tout à fait exceptionnel. Je pense que cette accumulation relève tout
simplement du hasard. Mais peut-être que si l’on sondait de manière approfondie l’inconscient des metteurs en scène, on découvrirait qu’à leurs yeux les cinq années écoulées en pleine société
bling-bling ont donné à la figure de M. Jourdain une valeur particulière… En ce qui me concerne, j’ai vu les trois Bourgeois parisiens et, parmi eux, celui de Laurent Serrano m’a paru
particulièrement intéressant. Pour monter son spectacle il s’est associé au Studio d’Asnières, que l’on a vu sur cette même scène de la grand-place en 2010 avec La Dame de chez
Maxim.
Après s’être demandé ce que pourrait bien être une "comédie-ballet" en ce début de XXIe siècle, il est arrivé à la
conclusion que ce serait très certainement une comédie musicale, et il a pris comme référence les films de Jacques Demy. Il a donc transposé Le Bourgeois gentilhomme dans les années
1950, sans changer un mot au texte de Molière mais en remplaçant la musique de Lully par une musique qui ressemble beaucoup à celle de Michel Legrand. Sa transposition, tout en robes vichy,
choucroutes et références cinématographiques, est très amusante et elle fonctionne parfaitement. Quant à savoir si M. Jourdain est un bourgeois bling-bling qui a juste envie de briller ou si, de
manière un peu naïve comme Bouvard et Pécuchet, il cherche vraiment à se cultiver, s'il se fait gruger par son entourage ou bien si c'est lui qui est trop bêta au départ pour s’imaginer qu’on
peut acquérir de la culture entre deux discussions d’affaires… Sur tout cela, je laisse le soin au public de se déterminer…
Jeudi 26 juillet. Jardin des Enfeus, 21h45.
Chez Jeanne (la jeunesse de Brassens). Spectacle conçu par Michel Arbatz à partir de lettres, de poèmes et de chansons de Georges Brassens.
J.-P. Tribout: Avec ce spectacle, j’ai découvert
des aspects de la vie de Brassens que je ne connaissais pas du tout: à partir d’un mélange de ses textes et de projections vidéos, nous sommes entraînés vers la jeunesse de Brassens, ses années
d’enfance, ses déconnades, la façon dont il a failli basculer dans la délinquance quand il était adolescent – il a tout de même été arrêté pour vol de bijoux – son passage au S.T.O., puis sa
rencontre avec la littérature, la poésie… Et le spectacle s’achève au moment où sa carrière commence à décoller, dans les années 1950 quand il arrive aux Trois Baudets. On entend beaucoup de
chansons peu connues, dont certaines qu’il a écrites pour d’autres interprètes – et elles sont très bien chantées, sans que les comédiens aient cherché à imiter Brassens.
Vendredi 27 juillet. Place de la Liberté, 21h30.
Norma Jean Baker, dite Marilyn Monroe, d’après Blonde, de Joyce Carol Oates.
Mise en scène de John Arnold.
J.-P. Tribout: Parmi les trois spectacles
programmés pour la scène de la place de la Liberté, j’avais quand même envie d’avoir un texte contemporain. J’ai pensé que celui de Norma Jean Baker, écrit d’après la biographie que la
romancière américaine Joyce Carol Oates a consacrée à Marilyn, était tout indiqué en cette année où l’on commémore le cinquantenaire de la mort de la star. Nous avons tout de même rajouté au
titre d’origine "dite Marilyn Monroe", parce qu’à mon avis, beaucoup de gens ignorent quel était le vrai nom de celle qui est devenue une véritable icône du cinéma. La mise en scène est signée
John Anrold, un comédien qui, dans le théâtre subventionné, est un peu une vedette – il travaille notamment avec Olivier Py, Stéphane Braunschweig… J’ai vu le spectacle en décembre; il est à mon
sens très réussi, très cinématographique, très bien interprété – la jeune comédienne qui joue le rôle-titre, Marion Malenfant, a été engagée à la Comédie-Française – et je suis sûr que ceux qui
viendront le voir l’apprécieront. On peut penser qu’avec le nom de Marilyn, le cinquantième anniversaire de sa mort, la notoriété de John Arnold et de Joyce Carol Oates, Norma Jean Baker
va attirer les foules mais je crois au contraire que c’est un spectacle assez délicat: pour les jeunes générations, Marilyn Monroe est une figure du passé, à peu près aussi lointaine de Greta
Garbo, par exemple. Et puis les cinéphiles ne lisent pas forcément le genre de biographies dont a été tirée la pièce… Reste qu’elle intéressera des publics très divers: les amateurs de cinéma
bien sûr, les habitués des scènes théâtrales qui seront curieux de voir le travail de John Arnold, ceux qui aiment les histoires très mélodramatiques – parce que la vie de Marilyn est un
véritable mélodrame…
Samedi 28 juillet. Jardin des Enfeus, 21 heures.
Appartements témoins, de Jean-Marc Chotteau. Mise en scène de
l’auteur.
Théâtre de La Virgule, Centre
transfrontalier de création théâtrale Tourcoing/Moustron.
J.-P. Tribout: Cette pièce a été écrite à
partir de témoignages authentiques recueillis auprès d’habitants de barres d’immeubles qu’on a décidé de détruire. Le texte fait entendre successivement la voix de ces gens qui, logés dans des
conditions précaires, et même s’ils détestent leur environnement, ont tout de même vécu là toute leur histoire; c’est leur vie qui s’est déroulée là, qui est attachée à ces immeubles… Cet
ensemble de témoignages est interprété par un seul acteur, Éric Leblanc, qui endosse tous les rôles. Ce parti pris est soutenu par une très belle idée scénographique qui est de montrer un mur en
partie démoli, avec une succession de boîtes à lettres qui, vues ensemble, figurent une de ces barres qu’on s’apprête à détruire. Et chaque boîte à lettres s’ouvre, comme une boîte à surprise. Ce
spectacle de grande qualité, avec sa dimension sociologique, a selon moi toute sa place dans la programmation du festival.
À l’énoncé de ce descriptif, me revient à l’esprit un reportage diffusé dernièrement au cours d’un journal télévisé: dans une
banlieue où l'une de ces barres était promise à la démolition, des journalistes avaient interviewé quelques-uns des résidents qui allaient devoir déménager. Parmi eux, une quadragénaire, que l’on
voyait lire devant la caméra le courrier lui annonçant la décision de la municipalité puis, ensuite, raconter qu’elle était née ici, qu’elle y avait grandi, construit sa vie d’adulte… Cet
appartement qu’elle occupait était même plus que sa vie: ses parents y avaient vécu avant de le lui céder. Résonances… Oui, j’irai sûrement voir ce spectacle.
 Dimanche 29 juillet. Place de la Liberté, 21h30.
Dimanche 29 juillet. Place de la Liberté, 21h30.
Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand. Mise en scène d’Anthony
Magnier.
Compagnie Viva la Commedia.
J.-P. Tribout: C’es t un très bon Cyrano que nous offre Anthony Magnier, joué à sept comédiens, ce qui est
une performance étant donné le nombre de personnages créés par Rostand. Chacun interprète donc plusieurs rôles, à l’exception du comédien qui incarne Cyrano. La mise en scène est très inspiré de
la Commedia dell’arte, mais avec peu de masques; c’est monté uniquement avec des tréteaux et des praticables qui tout d’un coup se transforment: ils deviennent le balcon de Roxanne, se retournent
pour figurer le siège d’Arras… les habitués du festival se souviendront probablement d’avoir vu cette compagnie au Jardin du Plantier en 2008, où elle avait joué La Princesse folle, une
pièce adaptée d’un scénario de Flaminio Scala – un auteur italien de la fin du XVIe siècle.
Lundi 30 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures.
Le Bouton de rose, de Sophie Accaoui. Mise en scène de Laurent
Lévy.
J.-P. Tribout: Ce spectacle-conférence a pour
sujet… le clitoris. Bien caché sous le titre, il n’en est pas moins évoqué franchement, à l’aide de textes littéraires, de chansons, mais avec de multiples sous-entendus. La conférencière est une
dame un peu… cul-serré qui, au fur et à mesure qu’elle prononce son discours, s’échauffe petit à petit. Avant de la voir sur scène à l’Essaïon, je ne connaissais pas la comédienne. Et elle m’a
convaincu: je ne dirais pas que c’est LE spectacle du festival mais il mérite le détour. Et bien entendu, il n’est pas destiné au seul public féminin, les hommes sont les bienvenus, et ils
pourront y apprendre des choses très utiles…
Mardi 31 juillet. Jardin des Enfeus, 21h45.
Le Vicaire, de Rolf Hochhuth. Mise en scène de Jean-Paul
Tribout.
Ayant vu la pièce lors de sa création parisienne en novembre 2011, j’en connaissais le sujet; aussi n’ai-je pas demandé à Jean-Paul Tribout de développements particuliers. D’autant que,
prévoyant d’assister à la représentation sarladaise, d’une part pour le plaisir de revoir une pièce appréciée, de l’autre pour savourer celui de la découvrir dans un autre environnement, j’aurai
sans doute matière à plus amples commentaires après les "rencontres plamonaises". C’est une autre date qui a suscité mes questions, la dernière du festival, en l'occurrence le 4 août: la mise en
scène de Monsieur chasse! – un texte de Georges Feydeau – est aussi signée Jean-Paul Tribout… Le sachant plutôt réticent à l’endroit des divertissements purs qui ne mènent à aucune
réflexion, sachant aussi combien lui tenait à cœur de monter la pièce de Rolf Hochhuth, je me suis dit qu’il y avait quelque anguille bizarre sous la roche de cette étrange cohabitation
programmatique. Mais non: rien de plus bizarre qu’une banale logique financière.
 J.-P. Tribout: Le Vicaire, qui a eu un beau succès critique, a été un échec commercial catastrophique. De tous les spectacles que nous avons joués au
théâtre 14, c’est celui qui a fait le moins de recettes et le tourneur, qui est aussi coproducteur, a perdu environ une dizaine de dates. Au départ, nous avions plus de vingt représentations
prévues, des dates fermes qui plus est. Et peu à peu la liste s’est réduite comme peau de chagrin; les directeurs de théâtre m’appelaient pour se désister: l’un avait subi des pressions de la
municipalité, l’autre préférait s’orienter vers une saison plus joyeuse… et nous avons fini par n’avoir plus que dix dates de tournée maintenues – dont Sarlat parce que je connais le directeur
artistique (rires). Comme le tourneur devait compenser les pertes occasionnées par Le Vicaire, il m’a dit: "Toutes les compagnies qui montent du Feydeau en ce moment remplissent
les salles. Alors si tu arrives à monter un Feydeau avec pas trop d’acteurs, je te le produis entièrement." J’ai donc cherché un peu dans cette direction, et j’ai trouvé Monsieur chasse!
Résultat: le spectacle commence à tourner dès cet été – nous sommes en pleines répétitions – et les dates se succèdent jusqu’en juillet 2013… Elles sont si nombreuses que j’ai dû établir une
double distribution pour permettre aux comédiens d’honorer les engagements qu’ils ont contractés antérieurement – par exemple cet été, c’est Jean-Claude Bouillon qui va jouer mon rôle, et comme
ensuite il part en tournée avec Claude Rich, c’est moi qui le remplacerai… L’échec du Vicaire en regard du succès que remporte le Feydeau est significatif de l’état du théâtre, de l’état
de la société, du monde: nous traversons une période où les gens ont d’abord besoin de rire. C’est vrai que, spontanément, je n’aurais pas choisi de monter du Feydeau mais je prends cela comme
une opportunité théâtrale: je n’ai encore jamais abordé cet auteur, et comme je me suis déjà confronté à Labiche, le rapprochement des deux expériences a son intérêt…
J.-P. Tribout: Le Vicaire, qui a eu un beau succès critique, a été un échec commercial catastrophique. De tous les spectacles que nous avons joués au
théâtre 14, c’est celui qui a fait le moins de recettes et le tourneur, qui est aussi coproducteur, a perdu environ une dizaine de dates. Au départ, nous avions plus de vingt représentations
prévues, des dates fermes qui plus est. Et peu à peu la liste s’est réduite comme peau de chagrin; les directeurs de théâtre m’appelaient pour se désister: l’un avait subi des pressions de la
municipalité, l’autre préférait s’orienter vers une saison plus joyeuse… et nous avons fini par n’avoir plus que dix dates de tournée maintenues – dont Sarlat parce que je connais le directeur
artistique (rires). Comme le tourneur devait compenser les pertes occasionnées par Le Vicaire, il m’a dit: "Toutes les compagnies qui montent du Feydeau en ce moment remplissent
les salles. Alors si tu arrives à monter un Feydeau avec pas trop d’acteurs, je te le produis entièrement." J’ai donc cherché un peu dans cette direction, et j’ai trouvé Monsieur chasse!
Résultat: le spectacle commence à tourner dès cet été – nous sommes en pleines répétitions – et les dates se succèdent jusqu’en juillet 2013… Elles sont si nombreuses que j’ai dû établir une
double distribution pour permettre aux comédiens d’honorer les engagements qu’ils ont contractés antérieurement – par exemple cet été, c’est Jean-Claude Bouillon qui va jouer mon rôle, et comme
ensuite il part en tournée avec Claude Rich, c’est moi qui le remplacerai… L’échec du Vicaire en regard du succès que remporte le Feydeau est significatif de l’état du théâtre, de l’état
de la société, du monde: nous traversons une période où les gens ont d’abord besoin de rire. C’est vrai que, spontanément, je n’aurais pas choisi de monter du Feydeau mais je prends cela comme
une opportunité théâtrale: je n’ai encore jamais abordé cet auteur, et comme je me suis déjà confronté à Labiche, le rapprochement des deux expériences a son intérêt…
Mercredi 1er août. Jardin des Enfeus, 21h45.
Journal d’un curé de campagne, de Georges Bernanos. Mise en scène et interprétation:
Maxime d’Abboville.
J.-P. Tribout: Je ne suis pas un grand amateur de
Bernanos, et ce roman n’est pas parmi mes préférés – on connaît mon anticléricalisme primaire (rires)… Mais en écoutant le texte, je me suis dit qu’il soulevait une problématique qui
pourrait être celle d’un hussard noir de la République, d’un médecin implanté en zone rurale – les questions que se pose ce jeune curé, les doutes qui l’assaillent sont ceux d’un homme qui, fort
de sa foi, de ses convictions, se trouve confronté à la réalité de ses ouailles: comment faire face à ces gens? Comment leur être utile, leur venir en aide? Un médecin, un instituteur peut très
bien s’interroger dans les mêmes termes. De plus, c’est formidablement interprété par Maxime d’Abboville, qui a obtenu un Molière pour ce spectacle-là – pour la petite histoire, il est de la
famille du navigateur Gérard d’Abboville. Je me souviens lui avoir proposé de jouer le personnage principal du Vicaire, mais il avait refusé parce que ça heurtait ses convictions de
chrétien. Il est tout de même venu voir la pièce… Après, il m’a dit: "Telle que tu l’as montée, j’aurais pu jouer le rôle que tu me proposais."
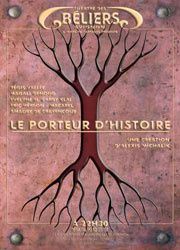 Jeudi 2 août. Jardin des Enfeus, 21h45.
Jeudi 2 août. Jardin des Enfeus, 21h45.
Le Porteur d’histoire, d’Alexis Michalik. Mise en scène de
l’auteur.
J.-P. Tribout: Pour moi, c’est le meilleur
spectacle du festival. Je l’affirme d’autant plus librement que j’ai aucune part de responsabilité dans son élaboration… L’auteur-metteur en scène, Alexis Michalik, avait présenté à Sarlat en
2010 La Mégère à peu près apprivoisée – sous-titrée une comédie musicale d’à peu près William Shakespeare. Ici on est dans un univers très différent, proche de celui d’Italo
Calvino, de Borges… C’est une création collective qui repose un peu sur le principe du roman de Potocki, Le Manuscrit trouvé à Saragosse: une histoire est racontée qui amène une autre
histoire qui elle-même en amène une autre et ainsi de suite, questionnant la place que peut occuper le récit dans nos vies. Le spectacle est simplissime: cinq acteurs, cinq tabourets, et un
portant avec des costumes. Les comédiens sont très talentueux. Hasard des distributions, deux des comédiens du Porteur d’histoire sont à l’affiche de deux autres pièces du festival:
Magali Genoud est Roxanne dans le Cyrano d’Anthony Magnier, et Éric Herson-Macarel joue dans Le Vicaire.
Vendredi 3 août. Jardin du Plantier, 19 heures.
Molière malgré lui, d’après Le Médecin malgré lui de Molière, et les films de
Laurel & Hardy. De et avec Guillaume Collignon et Jean-Hervé Appéré.
Compagnie Comédiens &
compagnie.
J.-P. Tribout: La compagnie qui a monté ce spectacle est spécialisée dans la commedia dell’arte. C’est un peu difficile d’imaginer que l’on puisse mêler, comme
ici, le texte de Molière à l’univers du slapstick et j’avoue que, si je n’avais pas vu le spectacle, je n’y aurais probablement pas cru. Mais je l’ai vu, et je me suis rendu compte que ça
marchait vraiment; c’est très bien fait, c’est très amusant. Ils avaient présenté à Sarlat une adaptation très inventive de La Flûte enchantée, en 2009, elle aussi plutôt surprenante; je
ne suis pas sûr que les amateurs d’opéra y aient trouvé leur compte mais, dans l’ensemble, le public avait été séduit. Je pense qu’il en ira de même avec ce Molière-là…
 Samedi 4 août. Jardin des enfeus, 21h45.
Samedi 4 août. Jardin des enfeus, 21h45.
Monsieur chasse! de Georges Feydeau. Mise en scène de Jean-Paul
Tribout.
J.-P. Tribout: S’il est vrai que j’aime bien monter des comédies, ce sont en général des comédies qui ont un propos de
fond, qui ne provoquent pas un rire tout à fait gratuit. Cela dit, j’aime aussi, dans les mises en scènes, jouer sur les disparitions/réapparitions, leur côté un peu guignolesque… et, sur ce
plan-là, une pièce de Feydeau, qui reste une machine à rire formidablement bien rodée dont on peut dire qu’elle se résume à des jeux de portes qui claquent, offre de quoi s’amuser… Et puis c’est
tout de même intéressant de se demander ce qui, chez Feydeau, à un siècle de distance et malgré les changements de mode de vie, de mentalités… fonctionne encore au point de faire toujours rire.
En me demandant "comment monter du Feydeau aujourd’hui?", je me suis dit que le "fond" de la pièce tenait en deux choses: des portes, un lit. Du coup, le décor que j’ai choisi se limite à cela:
un lit, des portes, et rien d’autre…
Article écrit grâce aux propos recueillis le dimanche 10 juin 2012.
/image%2F0577559%2F201306%2Fob_8c0425eb2632af0cf8fa7ee73380a48c_pitie-dangereuse-tn.jpg)

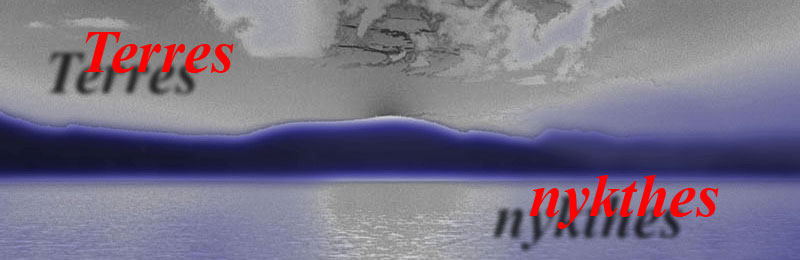



/image%2F0577559%2F201305%2Fob_9d40313c71f07e8afbee13f1f3a08653_affiche-chasse-jpeg.jpg)







 L
L Comment avez-vous travaillé l’adaptation? Quel a été le degré de refonte et comment avez-vous ajouté les divers éléments d’actualisation - par exemple
cette allusion à Johnny Hallyday?
Comment avez-vous travaillé l’adaptation? Quel a été le degré de refonte et comment avez-vous ajouté les divers éléments d’actualisation - par exemple
cette allusion à Johnny Hallyday?
 Arnaud Denis:
Arnaud Denis:
 Jeudi 19 juillet, midi.
Jeudi 19 juillet, midi.

 L
L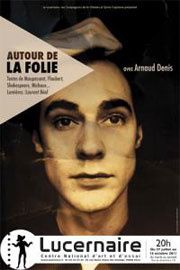 Vendredi 20 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures.
Vendredi 20 juillet. Abbaye Sainte-Claire, 21 heures. Dimanche 22 juillet. Abbaye Sainte-Claire: Journée des auteurs.
Dimanche 22 juillet. Abbaye Sainte-Claire: Journée des auteurs.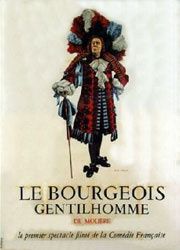

 Dimanche 29 juillet. Place de la Liberté, 21h30.
Dimanche 29 juillet. Place de la Liberté, 21h30.
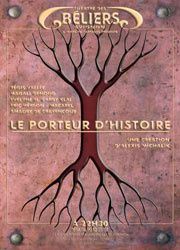 Jeudi 2 août. Jardin des Enfeus, 21h45.
Jeudi 2 août. Jardin des Enfeus, 21h45. Samedi 4 août. Jardin des enfeus, 21h45.
Samedi 4 août. Jardin des enfeus, 21h45./idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)