Voilà plus d’un an que je n’ai plus relayé dans ces pages
les notes de lecture de la Mère Michel. Tout en appelant son chat à cor et à cri, elle lit pourtant toujours autant, et rend compte de ses lectures avec une finesse allègre inchangée, de ce ton
si agréable qu’elle emprunte respectueusement à son alter ego l’écrivain Michel Host. Lequel sans désemparer et malgré ma défection continue de m’envoyer ses bulletins,
accompagnés de messages chaleureux et drôles, tout en sollicitude, qui m’émeuvent à chaque fois et me sont particulièrement précieux en ces jours de noire humeur… Je ne crois pas avoir su
exprimer combien j’étais sensible à l’attention qu’il me témoigne. Alors je lui adresse cette mise en ligne, et toutes celles qui suivront, comme je saluerais de loin en le voyant arriver un ami
cher…
Pour renouer avec ce qu’a lu la Mère Michel, je plongerai d'emblée, faisant pour le moment impasse sur toutes ses notes qui n'ont
pas encore émergé ici, dans le dernier bulletin reçu pour en extraire une précieuse récolte glanée dans le catalogue des éditions
Rhubarbe. Cela me permet de rendre hommage au passage – bien que par voie indirecte – au travail d'Alain Kewes, un éditeur que j'apprécie beaucoup et dont j'avais
suivi de près les premières publications. Voici donc trois livres à découvrir en la souriante et avisée compagnie de la Mère Michel…
 Cyrille de Sainte-Maréville, La Rose ensanglantée (roman), Rhubarbe, 2009, 120 p. - 10,00 €.
Cyrille de Sainte-Maréville, La Rose ensanglantée (roman), Rhubarbe, 2009, 120 p. - 10,00 €.
Cyrille de Sainte-Maréville est un voyageur de ce temps, un jeune écrivain qui de Varsovie à Montréal, des pays nordiques aux rives de la Méditerranée a déjà roulé sa bosse, en goûteur de vie et d’aventure. C’est aussi un voyageur de l’écriture: lauréat d’un prix de la nouvelle, en 2006, aux États-Unis, il a publié deux beaux recueils, A comme ailleurs (2002) et Faux semblants (2004), aux éditions Point de fuite.
Cyrille de Sainte-Maréville offre aux
jeunes lecteurs (mais aussi aux lecteurs adultes) ce roman tout bruissant de l’écho des batailles de chevaliers, flamboyant comme une oriflamme dans un soleil sanglant, aventureux comme une
échappée de guerriers sur les mers nordiques, mystérieux comme ces forêts obscures où s’ourdissaient les félonies et se commettaient les crimes impardonnables… Entre les hauts murs des
forteresses féodales, sur les rivages du mythe amoureux et de la passion inaltérable, un récit d’amour et de fidélité, d’attentes et de douleurs, de vie et de mort, de magies et de sortilèges, de
passions pures et violentes…
Le roi Hidegaard voit son royaume sombrer dans les violences des
combats; Logrid, sa fille, attend le retour de son preux chevalier Halking, dont elle ignore qu’il a été affreusement trahi. Prenez cette rose, elle sera auprès
de vous comme un baiser sur vos lèvres… lui avait-il promis. C’est désormais le chevalier Wirlock qui se présente devant elle. Princesse Logrid saura-t-elle l’aimer un jour? Quand
elle saura… pourra-t-elle pardonner? Le chevalier retrouvera-t-il le chemin de l’honneur et de la vérité? Halking reparaîtra-t-il? Le dénouement étrange de cette admirable aventure le dira au
lecteur. Il y galopera, de page en page… sans en sauter aucune!
Cyrille de Sainte-Maréville s’inscrit ici dans la tradition qui,
des récits légendaires de La Table Ronde aux visions moyenâgeuses de Walter Scott, constitue une splendide machine à rêver, train de l’enfance où honneur et déshonneur, loyauté et traîtrise,
amour éternel et haine inexpiable sont objets de foi et jalons d’une existence idéale… L’art de l’écrivain, restitution des atmosphères, d’une langue où chaque mot traduit les valeurs de ces
temps lointains, donne à ce roman son élan, sa puissance ramassée, ses longues saveurs d’Histoire.
Le fait que les élèves d’une classe de troisième auxerroise, se faisant éditeurs, aient "accompagné toutes les étapes de la fabrication
du livre", depuis la lecture du manuscrit jusqu’à la réception des ouvrages imprimés, se réconciliant ainsi avec la lecture et l’écriture, ajoute au charme singulier de l’ouvrage.
 Lionel Mirisch, Papiers mâchés (récits), Rhubarbe, 2009, 86 p. - 8,00 €.
Lionel Mirisch, Papiers mâchés (récits), Rhubarbe, 2009, 86 p. - 8,00 €.
Lionel Mirisch, après des études de droit et de sciences politiques, a choisi de travailler dans l’édition. Il a publié dans le
même temps plusieurs ouvrages: d’abord un recueil de nouvelles, Espace de la nuit (Denoël), puis des romans, dont l’admirable Vie des autres (Robert Laffont) que je republierais
si j’étais éditeur… Il a été critique littéraire à La Nouvelle Revue Française, La Quinzaine littéraire, ainsi qu’à France-Culture. Il compose aussi de la musique pour le
théâtre.
Comment dire l’existence, lier ses multiples événements, relier
les pensées, les rêveries, les inquiétudes de notre être que le hasard jette au monde? Comment "se" dire sans que pèse le poids intolérable d’un soi envahissant?
Lionel Mirisch a pris pour levier la distance et l’humour de
celui qui, se sachant de passage, va son chemin, ne se retournant que pour un regard bref. Son autobiographie, et le terme est bien lourd et pompeux, s’écrit à touches légères, dans le souci de
capter l’essentielle vérité. L’existence, dès lors, la sienne, la nôtre peut-être, la nôtre, oui, pour une part que chaque lecteur mesurera, se déroule suivant ses pentes naturelles, au fil du
Temps, au fil des mots qui nous lacent, nous enlacent et nous cassent! C’est là sa piste pour lever le lièvre de la vie.
Cette suite, comme chez Jean-Sébastien Bach, développe ses
séquences faussement proches les unes des autres, les propulse dans notre conscience tour à tour avec nostalgie, ironie, mélancolie et désabusement, à hauteur humaine… Musique intime qui s’avance
au bord de la prévisible absence, dans une lucidité sans compromis, sans apitoiements, sans afflictions de théâtre. Un parfait naturel dans une écriture d’une chirurgicale exactitude.
Plaisir et nécessité de la citation se font pressants: une page,
quelques lignes, diront un peu de la pointe douloureuse de notre temps de vivre!
Tout à l’heure, dans ma voiture je suis passé en bas de chez toi. Les volets n’étaient pas fermés, – oui comme
naguère, comme avant! Tu aurais pu aussi bien te montrer derrière la vitre, ou même, les battants écartés, te pencher contre le rebord et me faire signe: - Au revoir, au revoir… Mais ce revoir
hélas n’est plus possible, aussi, malgré l’obligation de maintenir le volant, durant quelques secondes j’ai baissé les paupières, qui m’ont paru de plomb. La voiture avait avancé, j’avais
dépassé, déjà, cette haute porte cochère par laquelle nous entrâmes, sortîmes tant de fois. Ensuite je dus m’arrêter au feu rouge. Tout ce bloc d’années, nos années, m’éblouissait encore. Et de
même ta silhouette, qui ne pouvait être loin – même si, je le sais bien, à présent elle n’a plus ici droit de cité. Ma douce bannie, tu ne te trouvais donc pas à la fenêtre, tu ne marchais non
plus dans ton appartement, tu n’y étais pas assise, ni étendue sur ton lit. D’ailleurs il n’y a là-haut désormais aucun lit, aucun siège pour prendre place et causer, les pièces provisoirement
sont vides, hélas qui sait? livrées à des monstres qui grattent les plafonds et déchirent les anciennes tentures. Quelqu’un donc osera, bientôt, se substituer à toi, respirer pour toi – contre
toi puisqu’il usurpera ton air? Alors le feu est passé au vert, et je me suis enfui. Comme on dit: tel un voleur. Qui de chez toi je te le jure n’aura rien pris, sinon de clairs, de transparents
souvenirs, et cette douleur pointilleuse, laquelle, je te le jure également, pour le restant de ma vie ne paraîtra s’user que pour revenir en moi l’instant d’après fortifiée.
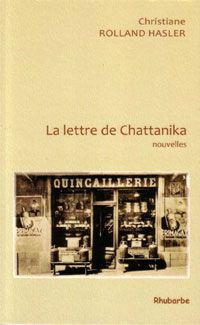 Christiane Rolland Hasler, La Lettre de Chattanika (nouvelles), Rhubarbe, mars 2010, 100 p. - 10,00
€.
Christiane Rolland Hasler, La Lettre de Chattanika (nouvelles), Rhubarbe, mars 2010, 100 p. - 10,00
€.
Les livres, comme dans le rêve bibliothécaire total de Borgès,
ne nouent-ils qu’une infinie tapisserie de mots? D’idées? D’aventures? De concepts?... Ne les distinguerions-nous pas les uns des autres seulement par le fait de notre incapacité à saisir cette
totalité dans une même pensée? Nos esprits sont fragmentaires, et en cela ils servent leur temps et nos souhaits: pourquoi voudrions-nous être identiques ou ressemblants? Classés dans une seule
et même catégorie? Il nous faut repérer tel plumet de chevalier dans la broderie de la Reine Mathilde, telle coiffure indienne dans une fresque de Diego Rivera pour pointer la spécificité du
"récit" qu’ils portent et qui les porte.
Celui de Christiane Rolland Hasler, La Lettre de
Chattanika, composé de trois nouvelles, nous transporte d’abord dans une ville banale, sans passé, sans histoire, mais un présent si
vivant. Ce présent est d’abord fait de la crue du fleuve. Il faut, ici et là, pour passer sur un autre bord, une autre rive, emprunter la barque d’un passeur. Une jeune fille,
Princesse, s’exaspère. Elle veut gagner la gare, là-bas, en face. La traversée est impossible. Avec Barnabé, dit Babar, le clochard, elle parle du soldat Kevin dont elle attend le retour. Babar
et Kevin, aussi démuni que lui, se connaissent. C’est le monde des petits et des sans grades que Christiane Rolland Hasler nous dépeint. Ceux-là sont comme fétus de paille sur les eaux toujours
en crue du monde. Toujours ils se replient lorsque le niveau monte. On attend donc, en mangeant une barquette de frites, un sandwich… On parle de la vie des soldats, et même de celle des
prisonniers, autrefois, en Allemagne. Princesse, c’est en Amérique qu’elle rêve d’aller. Immense traversée! Babar, lui, transite des abords de la gare au square le plus proche.
Un temps, Kevin et Princesse avaient vécu en ville: petit
studio, boulot de caissière. Prisonnier, lui aussi? Otage de l’ennemi? L’attendre encore? Tant d’incertitudes… Et Babar-Barnabé qui s’est éclipsé lui aussi, chassé de son square, de son banc.
Princesse? Solitaire: Toute sa vie devenait lâche, comme un pull trop porté. Alors elle part elle aussi, elle marche vers les lieux opposés aux lieux
de la guerre, jusqu’à une mystérieuse église en partie immergée : Notre-Dame-des-Otages. Fuir à nouveau, plus loin! Échapper à cet enlisement… Au hasard des bistrots, devant les écrans de
télévision, elle s’informe. Des soldats-otages, pourquoi donc? Monnaie d’échange, lui répond-on. Le gouvernement négocie. Le délire de Babar un instant retrouvé n’est d’aucune aide à Princesse.
La décrue s’amorce. Aussi la fin du conflit. Libération! Babar est extrait de la boue, mort! Drôle de printemps. Attendre Kevin encore un peu. Puis, partir. Le destin de Princesse semble être sur
les routes. Celui de Kevin quelque part entre la guerre et la paix, mais en vérité on ne sait pas.
Cette étrange nouvelle nous parle d’hier et d’aujourd’hui, et de tous les temps. Elle est fantomatique comme la guerre, désespérante
comme l’attente, doucement méchante comme la violence faite aux humbles, à ceux qui, ne maîtrisant rien, vivent à la merci de tout.
Partir est sans doute le leitmotiv du
recueil.
Le jeune Jack est parti, il a mis un océan entre la quincaillerie où sa mère le tenait à sa merci et sa vie: il est dans le nord
canadien, hors d’atteinte. Sa tante s’est lancée à sa poursuite, pensant d’abord le ramener en France, elle écrit à sa chère sœur Émilie, de
Chattanika, coin perdu, où personne ne va jamais, où transitent des fuyards et des apprentis
explorateurs. N’est-ce pas elle, la tante, qui jadis proposa à Jack ces livres d’aventures et d’exotisme qui le firent rêver? N’est-ce pas elle qui, comme son neveu, étouffait dans le vieux
magasin? Elle, qui la première rêva de voyages lointains, mais sans jamais oser?... Elle est enfin partie à son tour: une histoire de séduction commence. Jack un moment revenu, a de nouveau filé
entre les doigts de sa mère et de sa tante. C’est une joie, une délivrance que de le suivre sans le poursuivre, sans le serrer de trop près. Séduction du voyage, des paysages, du grand air de la
liberté. D’ailleurs, Chattanika - un trop beau nom pour qu’on en revienne - fait assez l’affaire de la tante. Pourquoi faire demi-tour désormais? Elle écrit: Émilie, je ne rentrerai pas. Je suis submergée de bonheur!... c’est Jack qui a raison.
Dans cette longue "Lettre de Chattanika", elle revient sur le
passé: Pierrot, le mari d’Émilie, traqué et surveillé par son épouse, parti lui aussi, car c’est avec la quincaillerie que tu es mariée… Son propre
passé aussi, sa vie en friche… Le réquisitoire est clair et net, argumenté ; la tante en fait sa proclamation d’indépendance, puis son acte
d’accusation. On en apprend de belles. Le secret de la naissance de Jack est une révélation. Laissons-en la surprise au lecteur. Vient le dévoilement d’autres secrets plus anciens. La logique du
récit qui se développe ensuite dépend de ces secrets-là… C’est ainsi, presque toujours, avec le petit commerce (et avec le grand aussi, j’imagine): un jour ou l’autre, il y a confrontation
directe avec la vie! La question est clairement posée: Pourquoi cette quincaillerie est-elle si sacrée? Quelles sortes de fibres la relient donc à notre famille
pour que toutes nos vies soient soumises à la prospérité d’une boutique? Sur la scène de ces vies, le spectacle a dérapé. "La
Lettre de Chattanika", belle nouvelle, construite et écrite avec art, s’achève sur une émouvante adresse à Jack, qui peut-être un jour en découvrira tous les mots. Ou peut-être pas. Qu’importe
puisque l’essentiel est de vivre sa seule et vraie vie.
"La maison Douce" clôt le recueil. Maison mystérieuse, sise dans
un village qui ne l’est pas moins. Une jeune femme, Élise, et ses deux filles y viennent occuper ladite maison et son jardin luxuriant. Elle est photographe, moins en villégiature qu’en séjour de
convalescence. Il semble que le déclencheur de son appareil ait occasionné il y a peu l’explosion d’un bâtiment et que les conséquences en aient été ravageuses… Coïncidence? Machination? On ne
sait. Reprenant force, Élise parcourt les rues du village qu’elle tente d’inscrire sur la pellicule: elles ne s’y impriment que par fragments. Des dames la visitent, qui paraissent sorties d’un
étrange passé. Leurs visages, leurs silhouettes ne peuvent non plus être captés par la pellicule. Elles semblent aussi connaître Élise. D’autres êtres sortent eux aussi du temps, le mari d’Élise
est parmi eux, qui toujours lui conseille de ranger son appareil. Elle monte pourtant dans les collines des alentours pour capter la totalité du village dans son viseur, mais des toitures claquent plusieurs fois avant de se soulever. […] Le village craque de tous côtés. […] Les façades crèvent comme sous le poing d’un géant fou. Où
est-il ce village? Dans quelles têtes? Quelles mémoires? Passé et présent ne font-ils qu’un? Qu’est-il arrivé? Qu’arrive-t-il? De l’eau monte… La nouvelle suggère assez. Elle dit assez. Cet
équilibre est tout un art subtil!
Michel Host
PS - Dans le bulletin dont sont extraites ces trois chroniques la Mère Michel évoque l’ouverture d’un "Jardin de
lecteurs". L’invitation tient en ces termes:
La Mère Michel tiendra désormais ouvert un Jardin réservé à ses lecteurs: ils s’y ébattront à leur
aise, aux jours et heures ouvrables (soit à chaque parution de ce bulletin), y rendant compte de leurs propres lectures, découvertes, expériences littéraires (ou autres…?) commentaires et
impressions sur les faits de culture ou d’inculture, bref sur le monde tels qu’ils le vivent et l’éprouvent, voire le font avancer vers les cimes ou les abîmes…
Pour espérer planter ses choux dans ledit jardin, il suffit d’envoyer sa contribution par courriel en pièce jointe – c’est souligné
dans le texte d’origine – à Michel Host, à l'adresse suivante:
michhost@sfr.fr

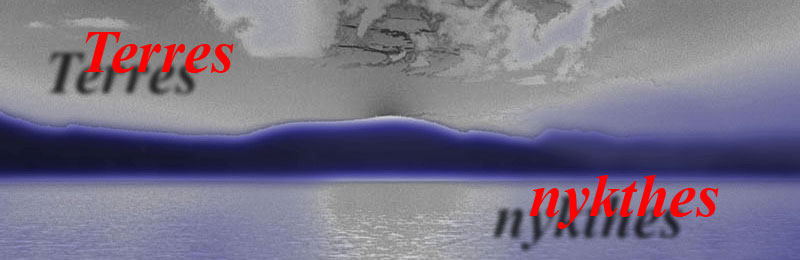


 L
L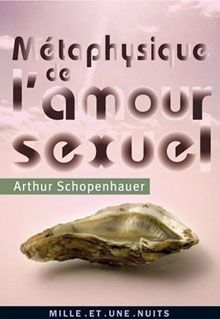 A
A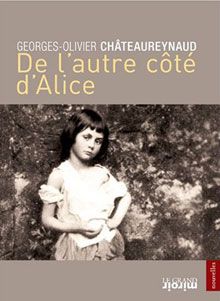


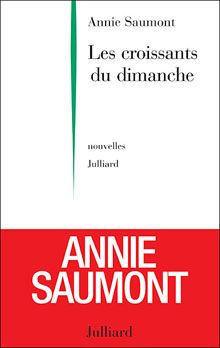
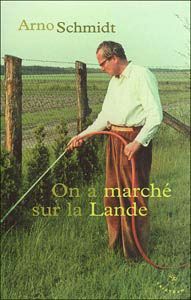
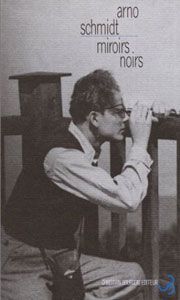 L
L À
À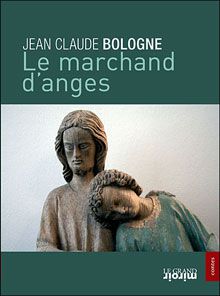 Jean Claude Bologne, Le Marchand d'anges, Le Grand Miroir coll. "Contes", janvier 2008,
168 p. - 15,00 €.
Jean Claude Bologne, Le Marchand d'anges, Le Grand Miroir coll. "Contes", janvier 2008,
168 p. - 15,00 €.
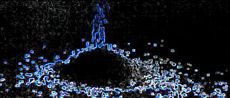

 A
A/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)