/image%2F0577559%2F20140202%2Fob_8c35da_parce-que-cetait-lui-tn.jpg)
Parce que c'était lui, parce que c'était moi... Derrière l'éclat de cette formule que l'usage a érigée en une sorte d'icône archétypale de l' "amitié idéale" et devenue un quasi-proverbe se cache, à bien y regarder, une nuit dont l'obscurité transfigure quelque peu la force mystérieuse de ce lien unissant Montaigne à La Boétie qu'ils sont censés exprimer. La nuit d'une question: pourquoi Montaigne n'a-t-il pas publié, serti dans ses Essais comme cela était prévu, le Discours de la servitude volontaire alors qu'il s'était engagé à entretenir la mémoire de feu son ami en publiant ses œuvres? C'est de là qu'est parti Jean-Claude Idée pour écrire sa pièce, en faisant de Marie de Gournay la messagère de ce questionnement – lequel, dans sa bouche, devient rien moins qu'une trahison: Je veux comprendre pourquoi vous avez trahi Étienne de La Boétie (scène 1), lui lance-t-elle tout à trac lors de sa première visite, avec un aplomb qui désarçonne un Montaigne vieillissant saisi presque au saut du lit et qui se sent "pris à l'abordage"...
Dramatiquement parlant, cette intrusion brutale de Marie dans la chambre de Montaigne, et la façon abrupte dont elle évoque ce qui est à ses yeux une trahison me semble manquer un peu de crédibilité. Mais ce procédé a l'avantage d'enrichir d'emblée le propos de la pièce et d'ajouter au "mystère La Boétie" la problématique à la fois amoureuse et intellectuelle que véhicule la relation en train de s'installer entre Marie et Montaigne. La "substance dramatique" est par la suite très habilement travaillée, en une suite de dix scènes fort bien rythmées, avec leurs justes silences et pics d'intensité, où un édifiant dialogue se renoue avec le défunt La Boétie par le truchement de son spectre venu visiter Montaigne pendant son sommeil et qui prendra ses quartiers jusque dans les moments de veille jusqu'à ce que surgisse la réponse à ce "pourquoi" obsédant: pourquoi Michel de Montaigne n'a-t-il pas publié le Discours de la servitude volontaire... Une réponse dont on comprend qu'elle éclaire autant l'ami trahi que le supposé traître. En même temps que les deux hommes l'on chemine vers la levée du voile tout en assistant à l'éclosion d'un amour sensuel et spirituel, cimenté de connivence intellectuelle, entre l'auteur des Essais et celle qui sera sa "fille d'alliance".
Avant d'être créée le mardi 21 janvier 2014 au Petit Montparnasse et de s'y installer pour plusieurs semaines – jusqu'à la fin du mois de mars –, la pièce de Jean-Claude Idée avait déjà derrière elle une "histoire publique" commencée au printemps 2013 sous forme de lectures*. Elle eut d'abord pour titre Montaigne et La Boétie: l'enquête. Ainsi intitulée, elle occupa, le dimanche 21 juillet 2013, dans le cadre du festival des Jeux du théâtre de Sarlat, la première partie de la "Journée des auteurs" – cette spécialité locale à la fois gastronomique et théâtrale qui, en échange d'un seul billet, permet aux festivaliers d'assister à deux représentations et de déguster, pendant l'intermède, une délicieuse "assiette périgourdine". C'était, déjà, un peu plus qu'une lecture; certes les comédiens tenaient chacun leur texte à la main, et leur regard s'y posait souvent mais les intonations étaient posées, et ils s'étaient rendus maîtres de tout un jeu vocal, juste et riche en nuances, qui dynamisait les dialogues avec une belle énergie. Des déplacements s'esquissaient, des attitudes, des postures... l'on devinait les prémices de la mise en espace.
Sur la scène du Petit Montparnasse, il m'a semblé retrouver, quasi intacts, les intonations, le rythme des répliques, les silences, la plupart des expressions qui à Sarlat modelaient les traits des interprètes... Mais cette fois sertis dans un "habillage" théâtral abouti: bande son accompagnant les noirs entre chaque scène, des costumes taillés à la mesure d'une évocation de la fin du XVIe siècle et des activités des personnages (chemise, culotte et surtout d'intérieur pour un Montaigne en chambre au petit matin, robe et manteau de voyage pour Marie de Gournay fraîchement arrivée de sa province...) dont on notera qu'ils sont réalistes sans être mimétiques stricto sensu et que celui de La Boétie est en outre lesté d'une forte signification symbolique – entièrement noir, il renvoie sans doute à la ténèbre de la question posée dans la pièce et à la matière même du Discours de la servitude volontaire, dont je me souviens qu'à Sarlat, Jean-Claude Idée avait dit qu'il était un granit noir. Un décor enfin, avec au premier plan une table tour à tour garnie de papiers et d’encriers ou de gobelets et d’assiettes, et flanquée de sièges d’un côté, un lit de l’autre et, à l'arrière-plan, des éléments aux formes fortement stylisées qui rompent étrangement avec ce réalisme figuratif faisant écho à celui des costumes, installé là comme un écran qu'il faut traverser: un arbre factice planté au beau milieu du plateau et dont le tronc se ramifie amplement, un vitrail bleu en arc d'ogive suspendu au plafond se détachant nettement sur les tonalités neutres d'un sol et d'un fond de scène unis. Cette composition géométrique quasi picturale, affinée par le rectangle parfait et mouvant du rideau blanc tendu derrière le lit, n'est plus seulement décor mais vectrice d'un message symbolique dont la teneur m'échappe (je pense pêle-mêle à l'arbre de la connaissance, au savoir qui serait l'axe primordial, à la partition entre monde des vivants et celui des morts que seuls les spectres peuvent ignorer... mais je suis probablement en pleine surinterprétation ou, au contraire, bien en deçà de ce qu'on a voulu signifier...).
Au bel équilibre de la structure dramatique correspond une construction d'écriture qu'à divers indices subrepticement perçus dès la lecture sarladaise je devine très fine, et tout en subtilités: ainsi entend-on semées çà et là plusieurs formules passées à la postérité – par exemple le monde est une branloire pérenne ou bien la phrase "à demi-titre", parce que c’était lui, que tout un chacun complètera sans erreur – mais pas forcément dans la bouche de qui les a écrites, laissant penser que Jean-Claude Idée a beaucoup "centonné" en entre-tissant son propre texte de bribes empruntées aux écrits de chacun des trois protagonistes et qu'il s'est ensuite non moins amusé à les faire prononcer par un autre que leur auteur. Repérer ces jeux ajoute bien sûr une profondeur de sens à la pièce à laquelle je ne puis pour ma part accéder car il me faudrait, pour cela, me replonger simultanément dans les Essais et le Discours de la servitude volontaire tout en découvrant les textes de Marie de Gournay. J'avoue que la persévérance me manque...
Souffrir d'un "défaut de références" n'empêche pas, je pense, d'apprécier un spectacle théâtralement agréable, superbement interprété, qui donne fort à réfléchir bien au-delà de la seule question de l'amitié et de la meilleure façon d'honorer la mémoire d'un ami défunt: ainsi le propos glisse-t-il souvent au débat philosophique, ressuscitant au passage de larges pans des Essais mais surtout le Discours de La Boétie dans toute sa vigueur, dans toute sa puissance en effet granitique. J'ajouterai que la pièce a pour autre mérite de faire briller le personnage de Marie de Gournay, injustement oubliée des féministes françaises au profit d'Olympe de Gouges selon Jean-Claude Idée qui lui avait rendu un bel hommage à Sarlat et avait mentionné qu'elle était l'auteur de plusieurs textes traitant de la condition des femmes, dont Le Grief des dames.
Aparté rétrospectif...
Marie de Gournay, Montaigne... Sitôt entendue la pièce de Jean-Claude Idée, elle entra en résonance avec Montaigne et le commerce conjugal, de Robert Poudérou, que j'avais vue dans ces mêmes jardins de l'abbaye Sainte-Claire en 2008, un certain dimanche 27 juillet, en clôture d'une "Journée des auteurs"... Le propos était autre, et la pièce aboutie quand celle de Jean-Claude Idée était encore en cours d'élaboration mais la résonance est évidente. Moins à cause des protagonistes engagés que du cadre, celui du festival des jeux du théâtre de Sarlat, dont je ne cesse, de mille et une manières et tout au long des mois, bien au-delà des trois semaines qu'il occupe chaque année, de percevoir les échos, les continuités, les bruissements réticulaires au gré de mes fréquentations théâtrales et qui me rendent à chaque occasion plus manifeste le rôle de "vase fécond" que joue ce magnifique festival.
Parce que c'était lui
Pièce de Jean-Claude Idée.
Mise en scène:
Jean-Claude Idée, assisté de Xavier Simonin.
Avec:
Emmanuel Dechartre, Adrien Melin, Katia Miran.
Décor:
Bastien Forestier.
Costumes:
Sonia Bosc.
Lumières:
Jean-Claude Idée.
Durée:
Environ 1h30.
Jusqu'à la fin du mois de mars au Petit Montparnasse, 31 rue de la Gaîté - 75014 Paris.
Du mardi au samedi à 21 heures, matinée le dimanche à 15 heures.
Réservation: 01 43 22 77 74.
Ouverture et (re)contextualisation...
Cette pièce fait partie des quelque quarante "leçons-spectacles" qui constituent la programmation des Universités populaires du théâtre, une initiative lancée fin 2012 par Michel Onfray et Jean-Claude Idée, dont le but et de remettre la raison, la réflexion et la connaissance au cœur du théâtre de notre temps par la représentation publique de textes de théâtre à caractères philosophique, éthique, civique, civique, historique et politique comme autant de miroirs tendus qui suscitent la réflexion, le débat public*. Ceci en réponse au constat que notre civilisation dite "occidentale" est aujourd’hui en déroute parce que la pensée authentique, fondée sur le savoir et l’examen critique, a beaucoup perdu de son poids, de sa présence. Mais pour revivifier cette pratique intellectuelle, il ne suffit pas de ranimer le rôle d’éveilleur de conscience qu’au fond – hormis des exceptions, bien sûr, comme toujours il y en a quand on formule un principe général – le théâtre a toujours eu, dût-il pour tenir ce rôle adopter la forme d’un divertissement d’apparence légère.
Encore faut-il toucher un public suffisamment large pour que cette dynamique ait une force, une ampleur à même de provoquer un réel et profond mouvement de prise de conscience. Aussi ces "leçons-spectacles" sont-elles conçues de manière très pédagogique: leurs enjeux sont soigneusement présentés à travers une sorte de conférence, donnée souvent par Jean-Claude Idée et /ou Michel Onfray, puis suivies d’un échange avec le public. Les textes, en simple lecture ou sous forme de spectacle entièrement montés, sont choisis pour leur richesse, exempte d’obscurités autant que de simplifications abusives. Et, parachevant le souci d’accessibilité qui anime les initiateurs de ces Universités populaires du théâtre, les représentations sont toutes gratuites, regroupées en une programmation étalée sur deux ou trois jours selon les lieux qui les accueillent – entre autres le Théâtre 14 à Paris, le Théâtre de Poche à Bruxelles ou encore sous un chapiteau, comme à Argentan en Normandie les 3, 4 et 5 mai 2013. Soutenues par la fédération Wallonie-Bruxelles, les Universités populaires du théâtre ont connu dès leur première saison, lancée en mars 2013 à Bruxelles, un très grand succès; de ce fait elles ont entamé leur deuxième saison dès l’automne 2013, au Théâtre 14 à Paris, avec Pourquoi ont-ils tué Jaurès?, de Dominique Ziegler, renforcées par le soutien de nombreux artistes et gens de lettres qui ont souhaité s’associer au projet, et prêtes à s’installer en de nouveaux lieux d’accueil.
* Citation extraite de l’appel lancé par Michel Onfray et Jean-Claude Idée, au moment de la création des Universités populaires du théâtre, reproduit dans le premier Cahier des Universités, qui vient tout juste d’être publié aux éditions SAMSA, et dans lequel on trouvera, outre un dossier complet concernant cette initiative, le texte de Parce que c’était lui accompagné du dossier de presse de la pièce, le Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie, une contribution de Michel Onfray intitulée "Le penseur de la sainteté libertaire" et une autre de Séverine Auffret, "Des femmes libres, des rebelles et des insoumises ou les saveurs de la liberté.
Ce premier Cahier est en vente au prix de 15,00 € au guichet du Petit Montparnasse et en ligne, sur cette page du site des éditions SAMSA.

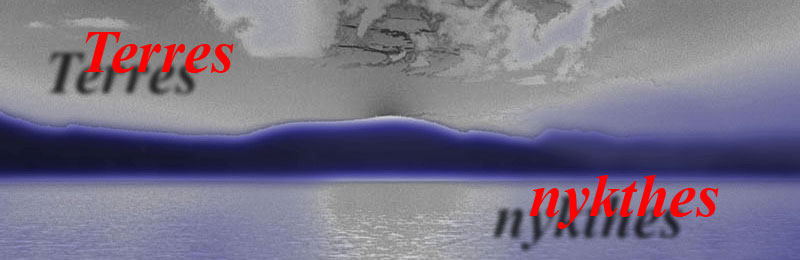



/image%2F0577559%2F201311%2Fob_644a8a489688529fe1bbf921c54f3381_inconnue-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201310%2Fob_fe5d560688647dfb3428cd09a60406d0_affiche-perturb-tn.jpg)

/image%2F0577559%2F201309%2Fob_1018419c806f04ddbe257e1c220ce395_alceste-cigale-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201309%2Fob_9838948a09ed0d3e40b1afc5964654d1_aveu-jv-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201305%2Fob_9d40313c71f07e8afbee13f1f3a08653_affiche-chasse-jpeg.jpg)
/image%2F0577559%2F201305%2Fob_6033a9e7359af589e4e2eae63ca8e255_roger-grenier-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201305%2Fob_9566466e103ce96157ebd814229347ff_carnet176-tn.jpg)
 N
N/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)