Le besoin – le besoin, non le désir, ou l’envie, ni même la pulsion au sens d’inclination incontrôlée quasi pathologique – de former des phrases, un texte, qui emprisonnent des fulgurances (constats, sentiments/sensations, pensées, résurgences, développements introspectifs, etc.) persiste dans sa force, et se mue plus souvent qu’à son tour en tourment. En véritable tourment, tel un rapace prisonnier de ma boîte crânienne qui tournerait là inlassablement, déployant ses lentes, régulières, oppressantes girations jusqu’à ce que je franchisse le seuil de l’acte scriptural. Soit en saisissant un stylo et une feuille de papier, ou bien en ouvrant le capot de mon ordinateur afin de jeter sur un «fichier word» ces mots et phrases accumulés dans le désordre jusqu’à déborder et exigeant impérieusement d’être mis en forme – i.e. ordonnés en une composition à la fois signifiante et qui fût pourvue de quelque intérêt esthétique. Il devrait en résulter un soulagement, un semblant de paix intérieure, dût-elle être temporaire… pourtant je bloque. Je laisse, de plus en plus longtemps, ces mots et phrases, passer en rangs serrés, planer ou au contraire stagner des jours et des jours en moi sans leur donner un semblant d’issue – une publication ici, fût-ce sous forme d’une «brève d’un jour», voire d’un «sans nom», ma dernière trouvaille catégorielle pour tâcher d’offrir une case acceptable à ces jets que je ne parvenais pas à ranger ailleurs mais sans pour autant savoir les jeter, les détruite. Une catégorie que je suppose mieux à même que les autres de ne pas rester déserte trop longtemps. À tort, ou à raison...
Mais où donc est le danger de telles publications, dans un blog aussi confidentiel que celui-ci? Faut-il qu’il soit immense pour que je me dérobe aussi souvent!
Je ne fais que répéter là (et en des termes différents je l’espère) un questionnement obsessionnel, un désarroi – un cri silencieux qui n’en hurle pas moins – maintes fois exprimé ici même et pourtant je me laisse aller une fois de plus à contempler cette étreinte sourde et maléfique qui enserre mon geste dans un étau avant qu’il aille à son terme afin d’essayer, une fois de plus, de m’en libérer. Mais c’est chose vaine car ces mots et phrases trouvés pour dire cette incarcération n’ordonnent nullement les profondeurs obscures que la lumière d’un texte dissiperait enfin. À sans cesse textifier autour de l’impossible écriture je me soulage à pas si bon compte que cela puisque «le dur», ce qui résiste contre vents et marées à la textification, continue de se lover immobile en moi tel un increvable abcès.
Je circonvolue inlassablement sans oser de pas décisif… je me sens très probablement mieux protégée d’un quelconque effondrement cataclysmique par l'empêchement imputable à cette angoisse qui littéralement me «prend aux tripes» chaque fois que je consens à «écrire» (alors qu’il n’y a objectivement pas le moindre enjeu) que par le consentement à l’écriture solutionnante, celle qui textifierait significativement cette masse molle, mouvante, dense et incandescente comme du plomb en fusion qui se meut tout au fond de mes abysses intérieures.
Voici une dizaine de jours, tandis que je lisais Le Donjon de Lonveigh de Philippe Le Guillou (j'y reviendrai [enfin... j'ai l'intention d'y revenir et une ébauche est écrite qu'il me faut étoffer, compléter, affiner - en d'autres termes remanier afin qu'elle prenne sens et s'ajuste au vouloir-dire qui est l'humus du texte]), une fulgurance m'a traversée qui m'a détournée un moment de la lecture, le temps de retourner la bande-test photographique devenue marque-page et d'y inscrire ceci, en lignes onduleuses et mal raboutées, au crayon:
Voir apparaître l’image au fond du bac de révélateur me donne le sentiment de vivre un moment lustral. Une épiphanie lustrale. En tirant – en travaillant en chambre noire –, je porte sur les fonts baptismaux mes douleurs et mes failles, mes fautes irrémissibles (que je n’identifie pas de manière certaine mais dont je sais qu’elles gisent là quelque part dans l’obscurité de mes pensées – et de mes peurs). Je les lave de leurs lèpres corrodantes et leur donne une légitimité de lumière, en noir et blanc, sur la feuille de papier baryté aux tons froids des hivers de l’âme.
/image%2F0577559%2F20240429%2Fob_b1fca8_introscopie-29-avril-2024.jpg)
À n’en point douter il y a là une clef. Quelque chose de fondamental qui se dit de mon rapport à la pratique photographique, sans quoi je n’aurais pas pris le risque – car il s’agit bien, dans cet acte d’écriture, d’une prise de risque même si je ne vois pas ce qui le revêt d’une telle gravité – de l’arrêter ici dans sa forme native presque sans retouche, telle que je l’ai notée sous le coup de son irruption, en ayant soin de surcroît de noter, aussi, les circonstances de son émergence (lesquelles doivent donc tout autant valoir clef).
De même doit valoir clef l'image que j'ai choisie pour accompagner ce texte. Elle était déjà épiphanique lors de la prise de vue: en 2004, au musée Bourdelle, dans ce qui était le logement du sculpteur, un grand crucifix médiéval en bois était exposé, face à un tableau protégé par un verre. Je cherchais, une nouvelle fois, comment capter, avec mon reflex Minolta, cet ineffable qui, dans le visage christique, me fascinait et que je n'avais pas encore réussi à fixer sur la pellicule en dépit de tentatives répétées (cadrage difficultueux, incidence lumineuse toujours insatisfaisante... et, de ma part, manque de cette habileté technique qui m'eût permis de jouer efficacement sur les réglages). Soudain, je perçois son reflet dans la vitre protectrice... j'élève mon appareil, je cadre, mets au point, déclenche... Une seule prise de vue. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Au développement, le négatif semble correct. Et le tirage confirme: j'obtiens exactement ce que j'espérais – une image à la fois assez explicite, et nimbée d'étrangeté, autant que de douceur, sans bruit intempestif. J'ai néanmoins essayé plusieurs fois de reprendre la même vue, chaque fois que je me trouvais dans cet espace avec une lumière analogue (et ce jusqu'à ce que de récents travaux chamboulent les configurations du musée, et que l'on déplace ce crucifix dans l'atelier) en espérant capter autre chose, un supplément quelconque, mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai revu dans mon viseur ce qui, alors, avait passé sur la pellicule. Là aussi, dans cette unique manifestation, quelque chose se dit (que je ne décrypte pas. Pas encore)...
Voilà désormais vingt ans que cette image conserve à mes yeux son pouvoir de signifiance.
Elle est donc «réussie», à l'exacte confluence de l'acceptable technique et de l'intention esthétique.

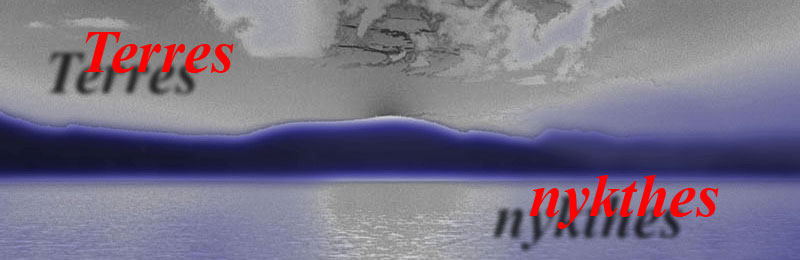












/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)