Cette année encore, Jean-Paul Tribout, en charge de la programmation du festival des Jeux du théâtre de Sarlat, m'a accordé une longue interview pour m'en présenter le programme, le temps d'une pause café prolongée le 13 juin dernier au Progrès (rue de Bretagne à ,Paris), généreusement taillée dans un planning bien rempli...
Deux étrangetés théâtrales – des OVNI qu’il faudrait convertir en Objets Théâtraux Inclassables – un "spectacle Carambar", quelques décoiffages assurés mais aussi de grands noms à l’affiche et, surtout, de la haute qualité à tous les niveaux et dans tous les registres: l’édition 2013 ne fera, semble-t-il, qu’ajouter des étoiles à la réputation déjà bien assise du festival de Sarlat. Comme à son habitude, Jean-Paul Tribout a pris des risques, par exemple en programmant une pièce alors qu’elle n’existait qu’à l’état de projet parce qu’il a entièrement confiance dans le metteur en scène et dans les comédiens (au moment de l’interview, les répétitions venaient de débuter), ou bien un spectacle dont il pense qu’il n’est pas totalement abouti mais auquel il trouve une telle force théâtrale qu’il estime pouvoir le proposer aux festivaliers – car on connaît son ambition: satisfaire un public le plus large possible tout en l’incitant à sortir de ses habitudes et à aller vers des spectacles susceptibles de le déconcerter, voire de l’agresser mais qui, par là même, le fera réfléchir et l’enrichira. Pour comprendre à quel point ses choix, à ces égards-là, sont justifiés, il suffit d’assister aux rencontres matinales organisées à l’hôtel Plamon…
LE CONTEXTE
Jean-Paul Tribout:
Concernant les conditions budgétaires, elles ne se sont pas améliorées: la volonté de l’État demeure de ne soutenir que les événements "à dimension nationale" comme le festival d’Avignon, les Vieilles Charrues, ou les Francofolies de La Rochelle, et d’abandonner aux collectivités locales – régions, départements, communes… ‒ le financement des manifestations de moindre envergure. Mais ces collectivités locales manquent elles aussi de moyens; elles peuvent, en outre, choisir de privilégier ce qui va favoriser l’afflux des touristes – par exemple la valorisation de sites par des spectacles sons et lumière, ou la mise en place d’attractions de type "Puy du Fou" ‒ au détriment de manifestations plus exigeantes. Fort heureusement, rien de tel à Sarlat, où la volonté politique de soutenir le festival de théâtre reste toujours forte. Il n’en reste pas moins que les subventions ont été restreintes – l’aide de la D.R.A.C. Aquitaine a baissé de 30% ‒ et qu’il a fallu diminuer le nombre de spectacles invités : il y en aura dix-huit, comme en 2012, au lieu de vingt auparavant. Deux spectacles en moins, ce sont des artistes et des techniciens qui ne travaillent pas, mais aussi des festivaliers qui restent moins longtemps, iront moins au restaurant ou à l’hôtel, fréquenteront moins les boutiques… En définitive, économiser sur les dépenses ampute les recettes – c’est se tirer une balle dans le pied. Et cela les politiques en sont bien conscients : un conseiller de la D.R.A.C. me confiait: "On sait bien qu’un euro de subvention crée véritablement un euro d’emploi artistique dans ces domaines-là" ‒ c’est-à-dire que l’argent alloué à l’organisation d’un festival comme celui de Sarlat ne vas pas être investi dans de la publicité ou des frais administratifs mais véritablement dans des emplois artistiques… il n’en reste pas moins qu’on a dû diminuer un peu le programme: tout le monde a fait des efforts mais vient un moment où les gens ne peuvent tout de même pas travailler à perte. Je crois cependant qu’en dépit des difficultés, la programmation reste exigeante et de qualité.
La Journée des auteurs a, cette année encore, perdu son label "S.A.C.D.": disposant de moins d’argent à cause de la baisse des prélèvements sur la « copie privée », due essentiellement à la dématérialisation des supports, cette société d’auteurs a dû renoncer une fois de plus à soutenir le festival. Si le ministère de la Culture suit les recommandations du rapport que Pierre Lescure a rédigé*, à la demande du gouvernement, concernant les revenus des professions artistiques à l’heure de la numérisation – des recommandations très favorables aux artistes et aux producteurs – on peut espérer voir remonter les revenus des sociétés d’auteurs, et comme 25% de ces revenus vont à la création, on peut penser que la S.A.C.D. reviendra nous aider comme l’A.D.A.M.I. l’a fait cette année.
Quant à la fréquentation, elle demeure stable ; on conserve à peu près le même nombre de billets vendus, c’est-à-dire environ huit mille – ce qui n’indique pas le nombre de spectateurs puisque beaucoup d’entre eux achètent plusieurs billets. Qu’il y ait une programmation réduite n’a pas grande influence sur les revenus de la billetterie car ceux qui viennent voir plusieurs pièces continuent à en voir plusieurs. Comme on ne veut pas augmenter le prix des places pour rester accessible, et qu’il faut tout de même faire face à cette restriction d’un tiers des subventions de l’État, alors on diminue le nombre de spectacles – pour ne pas pénaliser le spectateur, on pénalise, en fin de compte, les artistes car ce sont eux qui pâtissent de cette moindre possibilité de jouer.
* Le rapport Lescure, intitulé Culture-acte 2. Mission "Exception culturelle acte II", est publié en ligne sous forme de
En compulsant le dépliant, je repère aussitôt des noms connus – Laurent Rogero qui s’était avec un Don Juan dont il assumait seul tous les rôles grâce à un masque et à des figurines d’argile qu’il modelait sur scène (il avait aussi beaucoup "diatribé" contre les excès de pouvoir des metteurs en scène !); Jean-Luc Revol, Igor Mendjisky et la compagnie des Sans cou, Agathe Alexis… Et me frappe aussi la forte empreinte shakespearienne: pas moins de trois œuvres du "grand William" au programme!
Jean-Paul Tribout:
Au fil des éditions, il y a inévitablement des liens qui se créent entre des compagnies, des metteurs en scène et le festival: d’abord parce que, quand les gens ont du talent et font des choses intéressantes, on ne va pas se priver de leur travail sous prétexte qu’ils sont déjà venus et qu’il faut "changer un peu"; et puis ces liens, tissés par des rapports de fidélité amicale – ou d’amitié fidèle – permettent aussi de pallier, en partie, le manque de moyens: les compagnies nous donnent un coup de main, et consentent à quelques efforts financiers. Festival Shakespeare ? en effet, il y a trois pièces de cet auteur cette année, mais cela ne relève d’aucune intention particulière: ce sont les hasards des disponibilités, des contraintes propres au festival, qui ont réuni ces trois pièces. Mais c’est une circonstance très intéressante: on peut voir ainsi comment un même auteur peut être abordé de plusieurs manières totalement différentes; excepté le nom de Shakespeare, les trois spectacles n’ont vraiment rien en commun.
À tout seigneur tout honneur : c’est justement Shakespeare qui ouvre le festival…
SAMEDI 20 JUILLET, JARDIN DES ENFEUS.
Un songe d’une nuit d’été, mêlé à The Fairy Queen, de Henry Purcell. Mise en scène: Antoine Herbez (compagnie Ah !).
J.-P. Tribout:
Traditionnellement, j’essaie de programmer en premier un spectacle séduisant, populaire, agréable, plutôt festif… Celui-ci est essentiellement musical : le metteur en scène – qui n’est jamais venu à Sarlat – a adapté Un Songe d’une nuit d’été en s’appuyant presque davantage sur la musique de Purcell, postérieure de quelques années à la pièce, que sur le texte de Shakespeare, qu’il n’a pas hésité à couper. Il a supprimé toute la partie clownesque, jouée par des artisans qui eux-mêmes répètent un spectacle – de fait, c’est à peu près un tiers de la pièce qui a sauté. Mais il a compensé cette suppression par la présence de la musique, par de la chorégraphie… et je trouve que cela fonctionne admirablement. Quand j’ai vu le spectacle, il y avait beaucoup d’enfants dans le public, et c’était formidable de voir des gamins qui devaient avoir sept, huit ans, complètement fascinés par ce qui se passait sur la scène.
DIMANCHE 21 JUILLET, ABBAYE SAINTE-CLAIRE. JOURNÉE DES AUTEURS*
* Le principe de la Journée des auteurs est de proposer, pour l’achat d’un seul billet, une lecture et une pièce entrecoupées par un en-cas périgourdin réunissant artistes, organisateurs et spectateurs autour de grandes tables installées dans le jardin de l’abbaye.
18 heures
Montaigne et La Boétie: l’enquête. Texte de Jean-Claude Idée, lu par Emmanuel Dechartre, Adrien Meulun et Cathi Milan.
J.-P Tribout :
Cette lecture a été l’occasion d’une collaboration avec le centre culturel de Sarlat, qui souhaitait, au cours de l’année, proposer un spectacle sur La Boétie. Il se trouve que Jean-Claude Idée, qui est un metteur en scène ami avec qui j’ai travaillé mais qui n’est jamais venu au festival, doit monter à Paris en janvier 2014 – au théâtre Montparnasse, pour tout dire –, un texte qu’il a écrit, Montaigne et La Boétie : l’enquête. Et je trouvais intéressant de donner cette pièce en lecture avant qu’elle existe, d’autant que Sarlat est la ville natale de La Boétie. On sait que Montaigne a écrit Les Essais essentiellement pour promouvoir le Discours de la servitude volontaire. Or il n’a jamais publié ce texte dans ses Essais, dont la matière est lui-même. L’idée de l’auteur a été de partir de ce constat et de s’interroger sur les raisons qui ont présidé à ce changement ; son propos est de se demander quelle rivalité posthume a pu opposer Montaigne et La Boétie, quel amour déçu a surgi entre eux… pourquoi Montaigne, qui a toujours clamé son amour quasi homosexuel pour La Boétie, n’a-t-il pas tenu sa promesse de publier le Discours ? La pièce est une enquête : elle pose des questions, mais ne prétend pas y répondre…
19h30
Apéritif et assiette périgourdine
21 heures
Le contraire de l’amour, d’après le Journal de Mouloud Feraoun. Mise en scène: Dominique Lurcel (compagnie Passeurs de mémoire).
J.-P Tribout :
Nous voici en compagnie de Camus… sans Camus, mais avec Mouloud Feraoun, un écrivain et enseignant algérien qui était un ami de Camus et d’Emmanuel Roblès – dans ses Chroniques algériennes, Camus évoque Mouloud Feraoun, et on y entend beaucoup de choses qui figurent dans le Journal que cet écrivain a tenu – sur la recommandation de Camus, justement – pendant toute la guerre d’Algérie, jusqu’à son exécution par l’O.A.S. quatre jours avant la fin du conflit parce qu’il était, comme Camus, un esprit libre. Il n’était pas colonialiste, il voulait que l’Algérie évolue, c’était un intellectuel arabe, et pour l’O.A.S., c’était suffisant pour mériter la mort… Mouloud Feraoun est incarné par un comédien seul en scène, accompagné d’un musicien, qui dit des passages du Journal. Ce spectacle me touche beaucoup, d’une part parce que la guerre d’Algérie est une plaie qui n’est toujours pas refermée, et aussi parce qu’à travers lui est ranimé ce trio que formaient Camus, Feraoun et Roblès, qui tous trois incarnaient une certaine idée des rapports franco-algériens.
LUNDI 22 JUILLET, JARDIN DES ENFEUS.
Tour de piste, de Christian Giudicelli. Mise en scène: Jacques Nerson.
J.-P Tribout :
Voilà encore un spectacle coup de cœur… Je connais très bien le comédien, Stéphane Hillel; je connais un peu le metteur en scène, qui est aussi critique (il écrit notamment dans Le Nouvel Observateur et dans Valeurs actuelles), mais qui n’avait pas fait de mise en scène depuis plus de vingt ans – depuis Le Veilleur de nuit, une pièce de Guitry très peu connue dans laquelle jouait un "jeune comédien prometteur", qui n’était autre que Fabrice Lucchini! En sortant du petit théâtre où je suis allé voir le spectacle, j’étais assez émerveillé: le texte raconte la banalité d’une vie, celle d’un homme qui, adolescent, avait des ambitions artistiques – il voulait écrire, être un autre Rimbaud… puis la vie fait qu’il devient instituteur. Il se marie, sa femme le trompe, et lui la trompe de son côté… puis il arrive à l’âge de la retraite, et là il regarde par-dessus son épaule. À partir de ce texte, certes littéraire et agréable à lire mais qui ne raconte que des choses banales – les ambitions de jeunesse abandonnées, les petits arrangements avec la réalité, les espoirs nouveaux… bref, tout ce qui constitue, à quelques nuances près, la vie de tout le monde – il y a un magnifique spectacle théâtral, notamment grâce à l’interprétation magistrale de Stéphane Hillel. C’est cette banalité même qui sert à fabriquer véritablement du théâtre, avec rien d’autre qu’un acteur et un projecteur, et c’est formidablement réussi.
MARDI 23 JUILLET, ABBAYE SAINTE-CLAIRE.
Nous n’irons pas ce soir au paradis, d’après La Divine Comédie, de Dante (chants I, II, III, IV et V de L’Enfer). Mise en scène et interprétation: Serge Maggiani.
J.-P Tribout:
Parmi les grands acteurs français méconnus – je veux dire connus dans le métier mais moins du grand public – il y a Serge Maggiani. C’est le comédien fétiche de Christian Schiaretti, d’Emmanuel Demarcy-Mota ; il doit avoir une cinquantaine d’années et, comme son nom l’indique, il est d’origine italienne. Donc, Dante fait complètement partie de son univers, de ses références. Et il s’est fabriqué, à partir d’extraits de La Divine Comédie, un tout petit spectacle qu’il peut jouer n’importe où – il l’a joué au Théâtre de la Ville, il le reprendra là-bas cet automne mais il peut le jouer là, sous cet arbre, au milieu la place: il est seul en scène, avec un pupitre, parce qu’il a quand même un texte sous les yeux pour pouvoir naviguer dedans, et il nous raconte L’Enfer, en français et en italien – il y a très peu d’italien, 10 à 15 pour cent, et on comprend sans problème, il n’y a pas besoin d’être bilingue; et puis de cette façon, on entend la vraie musique des vers de Dante. Il ne dit pas le poème en entier: il n’utilise que quelques chants, auxquels il mêle des interventions personnelles, des commentaires, sur Dante, le pape… Serge Maggiani est un comédien qui a un charme fou. D’ailleurs, le spectacle a été remarqué par Télérama, qui l’a qualifié d’OVNI dans un article consacré au festival.
MERCREDI 24 JUILLET, PLACE DE LA LIBERTÉ.
Romeo et Juliet, de William Shakespeare. Mise en scène: Vinciane Regattieri (compagnie Magnus Casalibus).
J.-P. Tribout:
Voilà une pièce très connue, ce qui importe, ce sera donc non pas ce que ça raconte mais comment on le raconte. Et la manière de Vinciane Regattieri, qui signe la mise en scène, est encore plus décoiffante que celle de la compagnie des Mutants, qui avait présenté un Romeo et Juliet en 2009 mis en scène par Dominique Serron. Vinciane Regattieri était déjà venue à Sarlat il y a quelques années, avec des Précieuses ridicules très… décalées – on mangeait des crêpes sur le plateau, on jouait de la musique bretonne… C’est la marque de Vinciane, d’être un peu iconoclaste – et je suis assez bon public pour cela… Pour cette pièce, elle a repris le principe shakespearien de faire jouer tous les rôles par des hommes, y compris celui de Juliet. Et cela apporte une ambigüité qui, du coup, montre que l’amour entre deux êtres dépasse la distinction des sexes. De plus, l’ambiance est très hard rock – ça déménage vraiment! il y aura sûrement des grincements de dents, parce que beaucoup de spectateurs attendent sans doute un Romeo et Juliet un peu préraphaélite, mais dans sa démarche, c’est un spectacle très réussi et très riche qui, sur fond de mélange des genres et de musique assez violente, convoque la danse, l’acrobatie, les arts du cirque – il y a parmi les comédiens quelques circassiens… certains seront probablement choqués, ou déçus, mais ça n’en reste pas moins un spectacle qui fonctionne parfaitement.
JEUDI 25 JUILLET, JARDIN DES ENFEUS.
Une leçon d’histoire de France, de l’an mil à Jeanne d’Arc, de Maxime d’Abboville (d’après Chateaubriand, Michelet, Bainville et Duruy). Mise en scène: Jean-Laurent Silvi.
J.-P Tribout :
Maxime est un aristocrate, il appartient à une grande famille bretonne dont fait aussi partie le célèbre navigateur Gérard d’Abboville, et il est d’esprit plutôt conservateur – à cet égard, son choix d’adapter et d’interpréter le Journal d’un curé de campagne, que l’on a vu à Sarlat en 2012, est signifiant. C’est un très bon comédien et son idée de départ, pour ce spectacle, a été de se dire que l’histoire de France, après tout, c’était du théâtre… À partir de là, il a fait un montage de textes empruntés à des historiens sélectionnés de manière un peu arbitraire mais en respectant une parfaite parité: deux auteurs "de gauche" et deux auteurs "de droite": Chateaubriand, qui est quand même un sacré contre-révolutionnaire, Michelet, grand historien de la Révolution française et progressiste, Victor Duruy, et Jacques Bainville. Il se présente, pour ne pas tromper son monde, en instituteur à l’ancienne, devant un tableau noir et, en effet, il nous donne un cours d’histoire, mais il ne s’attache qu’à une partie de l’histoire de France – le titre du spectacle le dit: "de l’an mil à Jeanne d’Arc". C’est un spectacle très intéressant, mais de couleur disons "maréchaliste", voire pétainiste – évidemment, Maxime, à qui je faisais la remarque, s’en défend… Mais il reflète, en tout cas, cette volonté qu’il y a eu, sous la Troisième République, de créer ce qu’on a appelé le "roman national " et d’unifier l’histoire de France autour des grandes dates et des grands hommes. La façon dont Maxime raconte tout cela est très séduisante; ce n’est peut-être pas une œuvre exceptionnelle mais elle offre une belle matière à réflexion, à discussion – par exemple, je pense que, involontairement, il s’oppose à l’école des Annales, qui prône d’abandonner l’histoire des grands hommes au profit de celle des groupes sociaux et qui est une conception para-marxiste de l’histoire; et puis son histoire de France est coupée de celle de l’Europe. Mais comme il se limite à une période somme toute très courte, et qu’il puise chez des auteurs de qualité, cela donne un spectacle réellement attrayant.
VENDREDI 26 JUILLET, PLACE DE LA LIBERTÉ.
Don Quichotte, de Miguel de Cervantès. Mise en scène: Laurent Rogero (groupe Anamorphose).
J.-P. Tribout:
Laurent Rogero, qui avait présenté il y a quelques années au jardin du Plantier un spectacle sur Hercule, Héraclès, et plus récemment Don Juan, de Molière, a imaginé cette fois qu’une troupe devant jouer une adaptation de Don Quichotte voyait son spectacle annulé par la mairie parce qu’à la même date, un vide-grenier a lieu sur la place. Que faire, puisqu’on ne peut pas jouer? Eh bien on va vous lire Don Quichotte… ça commence donc comme une lecture, et peu à peu les comédiens s’emparent, parmi les éléments du vide-grenier, de tout ce dont ils ont besoin pour représenter Don Quichotte, et l’on voit du théâtre se fabriquer avec des objets a priori non prévus pour ça. Et puis il y a aussi une volonté de faire participer le public: le manque de moyens et de figurants les pousse, par exemple, à demander aux spectateurs de bêler quand ils ont besoin de signifier la présence d’un troupeau de moutons… c’est un spectacle joyeux, qui met bien en valeur le texte de Cervantès à travers les lectures et qui, surtout, interroge l’imaginaire que nous avons tous plus ou moins construit autour de don Quichotte. En outre, Laurent Rogero est un artiste aquitain – il est installé à Bordeaux – et je trouvais judicieux qu’il puisse montrer son travail sur la grand place.
SAMEDI 27 JUILLET, JARDIN DES ENFEUS.
Le Naturaliste, de Patrick Robine. Mise en scène et interprétation: Patrick Robine.
J.-P Tribout:
Voilà le véritable OVNI du festival… Patrick Robine est lui aussi bordelais; c’est un personnage tout à fait étonnant. Son texte, comme son interprétation, sont à la limite du surréalisme – en lisant Le Naturaliste, on se dit qu’il aurait très bien pu être écrit par les Surréalistes et, quand il l’interprète, il le fait en imitateur. Mais pas comme les imitateurs dont on a l’habitude qui imitent des personnalités: lui va imiter l’œuf en train de frire dans une poêle – il fait l’œuf, et il fait ça très bien! – ou encore le robinet qui goutte, qu’on vient fermer, et qui se remet à goutter… Est-ce encore du théâtre? En tout cas, le texte est littérairement très abouti, parfaitement publiable, et tel qu’il est interprété, ça devient vraiment du théâtre.
DIMANCHE 28 JUILLET, PLACE DE LA LIBERTÉ.
La Guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux. Mise en scène: Francis Huster (La Troupe de France)
J.-P Tribout:
La pièce de Giraudoux était à l’affiche du festival 2006, montée par Nicolas Briançon. Francis Huster, lui, l’a mise en scène il y a une vingtaine d’années, et il a décidé de reprendre ce spectacle cette année pour les festivals. On a donc là deux "noms", Giraudoux et Huster, et une pièce très connue – mais je n’ai pas vu le spectacle puisqu’il est actuellement en répétition. Cela dit, je connais le travail de Francis, et sa folie, aussi, dont je pense qu’elle peut très bien s’accorder avec Giraudoux. En outre, je connais bon nombre de comédiens dont il s’est entouré. Et puis je suis certain qu’Hélène de Troie sera très belle…
LUNDI 29 JUILLET, ABBAYE SAINTE-CLAIRE.
L’Apprentie sage-femme, de Karen Cushman. Mise en scène: Félix Pradier (En Votre Compagnie).
J.-P. Tribout:
Le spectacle a été créé au Lucernaire; il a déjà pas mal tourné et notamment, cet hiver, dans plusieurs villages de la région grâce à une initiative de l’Agence culturelle Dordogne-Périgord. Et à chaque fois l’accueil a été enthousiaste. Le texte est d’un auteur contemporain, mais l’histoire est censée se passer au Moyen Âge. C’est une sorte de conte initiatique, qui retrace le parcours d’une enfant trouvée qui apprend la maïeutique. Les qualités littéraires du texte sont grandes, mais le spectacle vaut surtout par l’interprétation d’une comédienne exceptionnelle, Nathalie Bécue, qui a été pensionnaire de la Comédie-Française et qui offre, sur scène, l’exemple de ce que peut être l’incarnation. Le spectateur est littéralement emporté par son jeu – elle est magnifique!
MARDI 30 JUILLET, JARDIN DES ENFEUS.
Richard III, de William Shakespeare. Mise en scène: Jérémie Le Louët (compagnie les Dramaticules).
J.-P Tribout:
J’ai vu la pièce à Paris, au Théâtre 13 Jardin; je suis tombé en arrêt devant quelque chose qui n’est peut-être pas tout à fait abouti, qui est peut-être critiquable et qui peut irriter certains mais qui, théâtralement, vaut le détour. Et je me suis dit que c’était intéressant de mettre ce Richard III un peu décapant en regard avec Un songe d’une nuit d’été… Il est monté par une jeune compagnie je ne connaissais pas, très battante, et très radicale. Ils font du théâtre en partant du principe qu’il faut affirmer la théâtralité, tout ce qui est excessif, histrionesque… mais avec les moyens d’aujourd’hui. Il y a une vraie modernité dans la mise en scène – par exemple dans l’utilisation du son, avec des micros, ou de la lumière, avec des néons, mais les effets ne sont jamais gratuits, loin de là. Et puis le personnage de Richard III est abordé d’une façon très inhabituelle : ordinairement donné comme un être disgracié, bossu, difforme, claudicant… il est, ici, un jeune homme plutôt beau, avec un côté très noir, très Nosferatu, mais sans disgrâce physique – le metteur en scène, qui interprète aussi le rôle de Richard, estime que la monstruosité du personnage n’est pas physique mais intérieure. Je trouve que c’est une proposition intéressante, qui va probablement soulever des discussions – comme la forme d’ailleurs, qui compte énormément dans le travail de Jérémie Le Louët; peut-être le fond souffre-t-il un peu de cette importance formelle? Je ne sais pas… En tout cas, la forme, pour radicale qu’elle soit, est belle.
MERCREDI 31 JUILLET, ABBAYE SAINTE-CLAIRE.
Black-out, de Lutz Hübner. Mise en scène: Jürgen Genuit (compagnie Théâtr’action).
J.-P. Tribout:
Ce texte, d’un auteur allemand, a été mis en scène par un Allemand… qui vit à Bordeaux depuis toujours ; c’est donc un artiste aquitain… Si je devais établir une correspondance avec une autre pièce venue à Sarlat, ce serait Oleanna, de David Mamet, montée par Patrick Roldez qui était à l’affiche en 2006. C’est, là aussi, un rapport professeur/élève qui est évoqué. L’élève, un adolescent qui est loin d’être un brillant sujet, va proposer un marché à son professeur – un deal, parce que pour lui, tout se règle par deal, c’est sa culture. Entre l’élève et l’enseignante, c’est un véritable choc des mondes et bien que cette pièce soit écrite par un Allemand, elle a tout de même de fortes résonances dans notre société. En ce qui concerne la forme, le texte alterne dialogues – quand il y a confrontation – et monologues – quand l’un ou l’autre des protagonistes réfléchit. Outre ses qualités théâtrales – mise en scène, interprétation, scénographie très signifiante puisque les personnages sont dans des cadres dont ils n’arrivent pas à sortir – la pièce intéressera un large public car les problèmes qui y sont abordés sont en prise directe avec notre époque.
JEUDI 1er AOÛT, JARDIN DES ENFEUS.
Huis clos, de Jean-Paul Sartre. Mise en scène: Agathe Alexis et Alain Alexis-Barsacq (compagnie Agathe Alexis).
J.-P. Tribout:
Nous voilà à nouveau en compagnie de gens connus… Sartre, bien sûr, et Agathe Alexis, qui a commencé à venir à Sarlat bien avant que je m’occupe de la programmation. Et ensuite elle est venue, en tant que comédienne, avec René Loyon, en 2010, dans Soudain l’été dernier, de Tennessee William. C’est une comédienne assez exceptionnelle, et aussi un grand metteur en scène. Huis clos, je pense que tout le monde ou presque connaît l’histoire: trois personnages aux caractères archétypiques se retrouvent en enfer… Cette pièce tend une passerelle entre théâtre et philosophie – même si le "fond philosophique" de Huis clos peut paraître un peu simpliste. On a d’ailleurs souvent reproché aux auteurs de cette période de se servir du théâtre pour faire des dissertations philosophiques de niveau scolaire – à cet égard, il suffit de lire Le Malentendu, de Camus… Ici, grâce à la qualité de l’interprétation et de la mise en scène, on a un très beau spectacle qui, créé dans un petit théâtre parisien, l’Atalante, demandera quelques aménagements scénographiques pour s’adapter à la configuration des Enfeus. Mettre en scène l’enfer au chevet de la cathédrale de Sarlat, ça va tout de même prendre une certaine résonance…
VENDREDI 2 AOÛT, ABBAYE SAINTE-CLAIRE.
Bouvard et Pécuchet, d’après Gustave Flaubert. Mise en scène: Vincent Colin.
J.-P. Tribout:
Avec cette adaptation d’une œuvre non théâtrale, on passe au registre de la comédie: l’histoire de ces deux "néo-ruraux", de ces deux scribouillards qui veulent aller vivre à la campagne, est très amusante. Là encore, c’est la forme qui compte, et elle est très simple: il y a deux tables, deux micros, et deux comédiens sur le plateau; on n’est pas du tout dans la représentation réaliste. Chacun des comédiens raconte les aventures de Bouvard et de Pécuchet, et ils les bruitent. En d’autres termes, le décor est sonore, "fabriqué", si l’on veut, par les acteurs au fur et à mesure, comme s’ils enregistraient une émission de radio dont nous serions les témoins. Cette trouvaille scénique, ajoutée à la qualité de jeu des comédiens, sert très bien le texte de Flaubert et on a une petite forme très réussie.
SAMEDI 3 AOÛT, JARDIN DES ENFEUS.
Les 2 "G", artistes de music-hall, d’après une idée originale de Jean-Luc Revol. Mise en scène: Agnès Boury.
J.-P. Tribout:
Voilà le "spectacle Carambar"*! Jean-Luc Revol est un habitué du festival et, dans la distribution, il y a Denis d’Arcangelo, que l’on avait vu en 2011 dans Madame Raymonde exagère. Tous les deux se connaissent – ils avaient travaillé ensemble dans un spectacle musical qui avait été récompensé aux Molières, Le Cabaret des hommes perdus, et là ils se retrouvent pour monter, avec des musiciens, cette histoire de deux vieux artistes de music-hall ‒ les "2 G" parce qu’ils s’appellent Georges et Gaétan et qu’ils son gay ‒ qui se remémorent leur carrière, assez ringarde il faut le dire… La période est difficile à situer, mais ce pourrait être l’immédiat après-guerre. Le spectacle est à la fois musical – les deux comédiens chantent et se livrent effectivement à un savoureux numéro de music-hall – et théâtral : une bonne partie de la pièce repose sur du texte, qui retrace leurs petites rivalités, leurs rapports avec les autres artistes, etc. On pourrait presque rebaptiser la pièce grandeur et misère de deux artistes de music-hall en fin de carrière, et c’est hilarant, vraiment hilarant du début à la fin.
* est réputé "Carambar" un spectacle en lequel le directeur artistique a une telle confiance qu’il promet un paquet de Carambar à tout spectateur présent à Plamon qui, le lendemain de la représentation, dirait qu’il ne l’a pas aimé…
DIMANCHE 4 AOÛT, JARDIN DU PLANTIER.
La Jalousie du barbouillé et Le Médecin volant, de Molière. Mise en scène: Raphaël de Angelis (compagnie Théâtre de l’éventail).
J.-P. Tribout:
Ces deux pièces de Molière sont assez rarement montées parce qu’elles sont courtes. La compagnie qui les présente vient d’Orléans, et son travail est centré sur le masque. Raphaël de Angelis, le metteur en scène, a pour particularité d’avoir beaucoup travaillé au Japon et ses spectacles sont marqués par l’alliance de deux traditions du masque : celle de la Commedia dell’arte et celle du théâtre No. Son autre particularité est de reprendre le même dispositif scénique pour tous ses spectacles : un simple rideau blanc en fond de scène. C’est un théâtre exigeant, mais comme les textes de Molière sont très comiques, c’est vraiment un spectacle tout public, qui de plus se plie à toutes les contraintes qu’impose une représentation au jardin du Plantier.
LUNDI 5 AOÛT, JARDIN DES ENFEUS.
Masques et nez, de la compagnie des Sans cou. Mise en scène: Igor Mendjisky.
J.-P. Tribout:
Cette compagnie était venue en 2009 avec un ... Ce spectacle-ci, qui a déjà beaucoup tourné – ce sera, je crois, leur 250e représentation! ‒, est très différent; tout est extrêmement précis, très carré dans la conception, mais avec toujours une part laissée à l’improvisation – un peu à la manière de ce qui se pratique dans un orchestre de jazz, où chaque instrumentiste peut improviser avant que tous les musiciens se retrouvent au chorus. C’est aussi le principe des lazzis dans la Commedia dell’arte. Dans Masques et nez, l’argument de départ est un cours de théâtre amateur, donné par un professeur à des élèves qui ont chacun d’autres activités en dehors du théâtre et une histoire qui leur est propre, avec ses aléas sentimentaux, professionnels, etc. Tous ces personnages sont profondément attachants, le spectacle est très enlevé: ce sera comme un point d’exclamation à la fin du festival. Et puis je trouve que c’est un beau message de clore le festival avec une pièce qui nous parle ainsi de l’amour du théâtre chez des amateurs.
Assumer avec la maestria et l’enthousiasme que l’on devine à travers ces propos la fonction de directeur artistique du festival de Sarlat n’empêche pas Jean-Paul Tribout de continuer à être pleinement comédien et metteur en scène. On peut en effet le voir jusqu’au 4 juillet 2013 au Théâtre 14 à Paris, où il incarne Duchotel dans de Georges Feydeau (dont il signe la mise en scène), et il réfléchit déjà à un nouveau projet théâtral: monter Les Mains sales, de Sartre. Il retrouvera là ce "théâtre questionnant" qu’il affectionne, bien éloigné des spectacles de digestion qu’il égratigne souvent mais sans malice lors de ses interventions plamonaises…

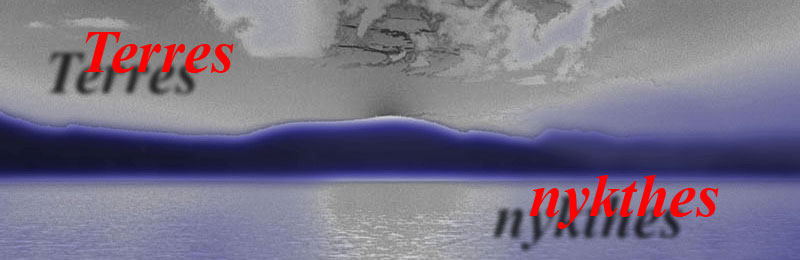

/image%2F0577559%2F20140204%2Fob_7cbbbd_avant-scene-909-tn.jpg)

/image%2F0577559%2F20140202%2Fob_8c35da_parce-que-cetait-lui-tn.jpg)

/image%2F0577559%2F201308%2Fob_f667ce_nathalie-becue1-tn-texte.jpg)
/image%2F0577559%2F201308%2Fob_f0feb0_cas-huster-helene-tn-texte2.jpg)

/image%2F0577559%2F201308%2Fob_d68be76fea52768f79ac70438edd8a25_sarlat-2013-progpf-tn.jpg)

/image%2F0577559%2F201308%2Fob_32948e4d1922a3bb644fd46ff96fc7ed_huis-clos-bis.jpg)

/image%2F0577559%2F201308%2Fob_dfcbf9de1bcc4a5fc56dd5f5942215ab_richardiii-librio-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201307%2Fob_1ed333cc0238508cd2b57ae84059bd47_repet-songe-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F201306%2Fob_917f20f35c258f0cdef7d76cb21ffc7a_sarlat-2013-proggf-tn.jpg)
/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)