Depuis juin cela couvait. Un magma bouillonnait en moi sans
trouver de cheminée par où s'écouler depuis ces jours de juin au cours desquels j'ai lu, presque à la file, deux textes de Richard Millet, Intérieur avec deux femmes, et De
l'antiracisme comme terreur littéraire.
Il me faut tout d'abord confesser qu'avant d'être confrontée à ces textes je ne savais pas qui était Richard Millet – je me rappelais
juste avoir croisé son nom au détour d'une lettre d'information de prixlitteraires.net annonçant qu'il avait reçu
le prix des Impertinents 2011 pour Fatigue du sens. Je me souvenais aussi qu'alors le titre m'avait assez agréablement chatouillée car j'ai tendance à penser que l'on baigne dans une
espèce de n'importe-quoi généralisé qui, par exemple dans le domaine artistique, fait se pâmer de beaux esprits devant des étrons soigneusement emballés dans des discours spécieux les érigeant en
"œuvres d'art", et crier au génie dès qu'une création, quelle qu'elle soit, s'avère parfaitement hermétique – "C’est conceptuel, voyez-vous… Comme c’est profond, comme c’est grand… Abyssal!!"
(id est: "extraordinairement génial"). C’est en effet comme si la signifiance, trop lasse, s’en était allée se cacher pour mourir…
Comment en serait-il autrement quand les mots eux-mêmes sont
vidés de leur capacité à signifier par des usages abusifs – lorsqu’on qualifie de "tueries" ou de "massacres" des affrontements occasionnant deux ou trois victimes, comment doit-on évoquer ceux
qui se soldent par des centaines voire des milliers de morts? Je ne crois pas que le lexique français courant offre rien qui aille, en termes d'ampleur et de gravité, au-delà du "massacre". On
peut tenter le "bain de sang", ou encore l’"hécatombe"… mais ces mots restent d’une intensité similaires à ceux que l’usage a épuisés… Cinq morts ou plusieurs centaines, cela n’est évidemment pas
pareil. Pourtant les discours ambiants se tiennent "comme si".
Bref: ayant supposé que Fatigue du sens abordait ce type de problématique, je m’étais intéressée au livre. Mais la lecture de
sa présentation m’avait vite douchée: j’y avais senti le vilain parfum d’un nationalisme peu ragoutant – je veux dire: qui ne me ragoute pas – et avais aussitôt renoncé à le lire. Richard Millet
fut relégué au fin fond de ma mémoire, suffisamment loin pour que j'aborde sans aucune prévention ces deux textes.
Dès les premières pages d'Intérieur
avec deux femmes les remugles qui m’avaient effleuré les narines quand j’avais survolé la présentation de Fatigue du sens me revenaient à la figure par larges bouffées pour
continuer de m'incommoder, et me poursuivre bien après que j'eus franchi le point final – et spermatique – de ce "récit". Ce malaise qui le prend dans une gare de R.E.R parce qu'en début
d'après-midi, il constate qu'il est entouré de voyageurs à l'épiderme trop foncé à son goût; sa vision des Roms – il a toujours été, écrit-il, fasciné par la
laideur de cette ethnie… Que l'on se sente incommodé des bavardages à voix excessivement hautes dans un espace
public confiné, que l'on réagisse vigoureusement à des postures, des paroles agressives, à des impolitesses, des actes violents, de vandalisme ou de délinquance, soit.
Mais que l'on puisse être gêné aux entournures par une couleur de peau, non, cela dépasse mon entendement. Et je ne comprends pas davantage que l'on soit capable de réduire un groupe humain à une
appréciation esthétique, beauté ou laideur. Cela m’a révoltée, et dans la suite du livre les motifs d’indignation ont continué de pleuvoir – par exemple sa répulsion obsessionnelle pour les
mosquées s’élevant depuis peu dans les cieux européens ou encore son ennuyeuse complaisance à se présenter comme un "écrivain infréquentable" (mais il publie beaucoup, et chez plusieurs éditeurs…
il est plutôt bien reçu pour un "infréquentable). Je n’avais pas fini de bouillir que son pamphlet tirant à boulets ardents sur l’antiracisme et le multiculturalisme accroissait ma colère.
Cependant ces réactions restaient confuses; violentes mais
confuses, et je ne parvenais pas à aller jusqu'au bout de cette colère, à la verbaliser. Quelque chose se dérobait; je me rendais compte que "ça n'allait pas", que la lettre des textes, leur
premier degré si l'on veut, m’entraînait sur un terrain d’indignation qui n’était pas le bon… sans me donner d’autre prise que cette lettre-là pour réagir. Ainsi m’était-il impossible de ne pas
m’insurger contre son aspiration à préserver une "pureté culturelle" – selon moi cette idée même de "pureté culturelle" est un non-sens puisque, s’il existe bien des cultures singulières
qu’il faut évidemment respecter, chacune de ces singularités a l’épaisseur diachronique d’une Histoire particulière, stratifiée de mille diversités s’étant conglomérées au fil des temps; c’est le
mouvement, la dynamique d’une humanité qui, depuis qu’elle a commencé de se développer, ne cesse de migrer, de faire souche ici pour ensuite s’en aller ailleurs, assimilant au passage un peu de
chaque lieu et de ses occupants (croyances, coutumes, langues…) Un mouvement général s’effectuant presque toujours dans la douleur par le truchement de conquêtes, d’assujettissements puis de
révoltes contre les oppresseurs, des soubresauts historiques qui, aussi tragiques fussent-ils, déposent dans les mémoires des alluvions formant peu à peu les cultures, les civilisations –
tout en ayant l'intuition que je me trompais de combat. Et sans parvenir à déceler où pouvait bien gésir mon erreur.
Cela s'énonçait en moi mais je ne me
reconnaissais aucune légitimité pour l'exprimer – ni historienne, ni sociologue, en nulle matière érudite, je ne pouvais que déployer des arguments intuitifs, émotionnels, bâtis sur des
savoirs glanés au hasard et peut-être mal assimilés; de plus, on m'avait expliqué qu'en réalité la pensée de Richard Millet était autrement plus complexe que ce que j'en avais compris, qu'il
était important de la recontextualiser dans l'histoire personnelle de l'écrivain, son parcours littéraire et, surtout, qu'il me fallait explorer ses autres livres – à cet égard, il y a peu de
chances que je suive la recommandation: ce que j'ai lu dans Intérieur avec deux femmes et De l’antiracisme comme terreur littéraire a dressé pour l’heure un mur infranchissable
entre ma curiosité et le reste de son œuvre. De plus, rien dans ces deux livres – j’insiste: dans ces deux livres, les seuls que j’aie lus – ne
m’a inclinée à estimer "immense" son talent; peut-être l’est-il ailleurs mais, selon moi, pas là. Certes la langue est bien maniée mais j’ai parfois trouvé des phrases obscures et j’ai souvent eu
l’impression, dans quelques passages d'Intérieur avec deux femmes, d’avoir sous les yeux de vagues imitations proustiennes mais de petite pâte, qui ne m'ont pas incitée à la
gourmandise…
Pour que tout se débonde il aura fallu qu’explose "l’affaire Millet", un véritable ouragan de tollés et de contre-tollés
autour d’un texte d’une petite vingtaine de pages au titre provocateur, Éloge littéraire d’Anders Breivik, à l’évidence choisi pour embraser des passions d’autant plus inflammables que
ledit texte (publié dans un volume avec un autre texte intitulé Langue fantôme) a surgi sur les étals presque en même temps qu’était prononcée la sentence condamnant le tueur norvégien à
vingt et un ans de prison ferme, soit la peine maximale encourue par un criminel en Norvège. Le titre est si provocateur qu’il a paraît-il entraîné des journalistes à écrire de violentes
diatribes contre M. Millet sans avoir lu le pamphlet incriminé… La perche était tendue aux défenseurs de l’écrivain pour s’indigner à leur tour – à juste titre d'ailleurs car il n'est guère
honnête de commenter un livre qu'on n'a pas lu et d'extrapoler à son sujet – et dénoncer de nouveaux méfaits de la mauvaise foi bien-pensante, la tentative de musellement d’un grand auteur, etc.,
etc. La machine ne cesse de s’emballer depuis la sortie du livre – articles de presse, interventions sur la Toile, émissions de radio, de télévision… – et la rituelle "rentrée littéraire" d'être
tout entière dominée par "l'affaire": une petite vingtaine de pages aussi dévastatrice que le fameux "battement d'aile du papillon". Quelques réactions me sont tombées entre les oreilles sur
France Culture (par exemple la première partie de La Grande table le 7 septembre), et sous
les yeux ici et là sur la Toile dont un
texte signé J.M.G. Le Clézio… Quelle mise en vedette! M. Millet n’en espérait sans doute pas tant. Et je crois que cela continue d'enfler, hors de toute raison…
Je n’ai pas lu l'Éloge honni et
n'ai aucune intention de le faire. Mais tout ce qu’il provoque, notamment l’article de J.M.G. Le Clézio, et celui que Pierre Jourde a publié sur le site du Nouvel
Observateur, m’a amenée à reconsidérer les deux livres qui m’on tant troublée. C’est une sorte de sidération: je me dis que ce battage nous ramène à ce point déplorable où une œuvre n’existe
plus qu’à travers ce qui se dit d’elle, où un homme ne se sent exister qu’à travers ce que les circuits médiatiques font de lui. Et que ces écrits qui rendent Richard Millet prétendument
"infréquentable" ne sont pas tant des "textes d’opinion" mais des attracteurs de foudre, rédigés à dessein par un auteur cherchant davantage à être fustigé pour pouvoir se poser en victime qu’à
faire valoir ses idées, ou son talent de littérateur. Ce qui expliquerait ce sentiment étrange que m’ont laissé mes lectures, cette violente nausée, cette allergie de contact spontanée et un peu
primaire dont je pressentais qu’elle n’était pas tout à fait adéquate…
In fine me vient l’envie, en sortant de cette ronde dans laquelle je suis entrée comme trop d’autres, de pousser
une grosse gueulante, et de dire "MERDE" à la bien-pensance autant qu’à l’obligation qui nous est faite de la mépriser, de dire "MERDE" à cette habitude que l'on a de considérer
comme suspect tout individu qui l’ouvre – vous proclamez-vous altermondialiste et vous voilà au pire soupçonné d’hypocrisie, au mieux taxé de minable bien-pensant, propagateur d’une "pensée
droit-de-l’hommiste" désormais décrétée insupportable (mais par qui au fait? Quelles sont donc ces instances sociales, politiques, qui décident du "bon ton" et du "condamnable"? peut-être au fond
est-ce seulement "l’usage" qui décide donc vous et moi, nous tous confondus en masse – "confondus": c’est bien le mot; tout, son contraire et son contre-contraire étant à la fois objet de haine
et de vénération), ne l’êtes-vous point et vous voilà rangé parmi les affreux réacs pillards de planète… Affirmez-vous que vous êtes partisan d’un enseignement moral et l’on vous immole sur le
bûcher promis aux psychorigides corseteurs d’esprits, êtes-vous frileux devant la morale que l’on vous accusera d’être un de ces dangereux laxistes par lesquels le chaos, un jour, arrivera… Et
ainsi de suite.
M ais on est DÉJÀ, me semble-t-il, dans le chaos, ou plutôt dans la confusion – ce n’est pas tout à fait pareil, le premier est séisme, la seconde
simple brumasse!
Il serait peut-être temps de retrouver le sens du sens, de réapprendre à écouter, à observer puis à entendre les choses, les faits, les
gens… non pas pour formuler des réponses – forcément péremptoires parce qu’une réponse, c’est comme une solution: toujours exclusive de mille autres – mais pour retrouver, en même temps que celui
de la signification, le chemin du questionnement. Et se tenir à l’écart de celui des assertions.
Qu'aurait donc pensé de cette "affaire" un auteur comme Philippe
Muray, dont je découvre, par toutes petites bribes, les textes décapants? Sûrement quelque chose de très caustique, de très drôle – et d'infiniment pertinent.
/image%2F0577559%2F20220412%2Fob_23310d_artistic-theatre.jpg)

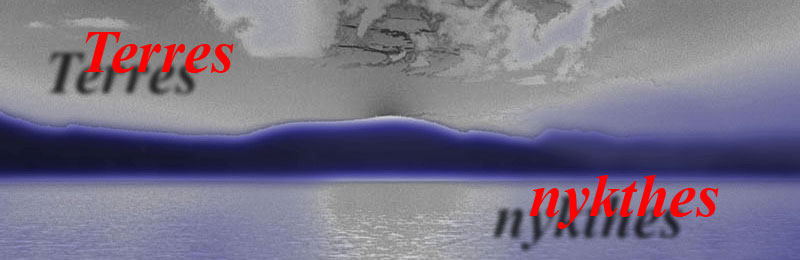





/image%2F0577559%2F20150112%2Fob_6d5f65_cours-ma-tn.jpg)
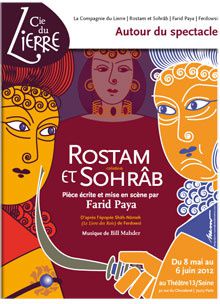 Coïncidences,
reviviscence
Coïncidences,
reviviscence U
U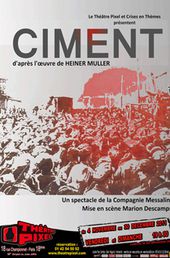 D
D/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)