En octobre dernier, l'ouverture, hautement médiatisée, de l'exposition Picasso.mania au Grand Palais avait donné lieu, entre autres initiatives touchant à cette figure majeure de l'art du XXe siècle qu'est Pablo Picasso (et l'on sait par ailleurs quelle icône il est devenu, inscrit désormais dans la mémoire culturelle du plus inculte des quidams ne serait-ce que du fait de l'association de son nom à un modèle d'automobile dont on se demande bien quel rapport celui-ci peut avoir avec les œuvres et les recherches esthétiques de l'artiste...), au lancement d'un de ces "cours en ligne pour tous" ‒ les fameux MOOC, (Massive Open Online Courses, en bon français) qui fleurissent en France depuis peu et semblent avoir d'emblée connu un immense succès. Assez mal contente de réaliser, moi qui me targue d'un intérêt prononcé pour les Beaux-arts et de me complaire à tous les questionnements qui de près ou de loin leur sont liés, que mes connaissances à l’endroit de Pablo Picasso n’excédaient pas celles du "grand public" ‒ je veux dire par là qu’elles se limitaient à un improbable faisceau mêlant, à deux ou trois œuvres emblématisées par les diffusions tous azimuts, quelques-unes de ces informations "people" dont on est pénétré sans avoir particulièrement cherché à les emmagasiner ‒ mais consciente, aussi, que cette ignorance résultait d’une affectivité peu émue par l’esthétique picassienne qui m’avait jusqu’alors détournée d’une œuvre pourtant capitale au regard de l’histoire de l’art, je me suis inscrite à ce cours à titre d'initiation.
Pour avoir déjà suivi de ces MOOC, pour la plupart d'ailleurs interrompus avant leur terme car il me semblait que, dans leur conception, le désir, et la nécessité, de vulgariser avaient abouti à de trop flagrants manques ou simplifications, je me doutais qu'il ne pouvait rien être de plus qu'une initiation mais c'était, précisément, ce dont j'avais besoin : un simple point d’appui à partir de quoi je pourrai, éventuellement, pousser ensuite plus loin mes explorations. De plus, ce type de cours, tout lacunaire qu'il soit, a pour moi cet avantage que s’en trouvent comblés ma curiosité et mon appétit de découverte en tant qu’ils sont inclination à apprendre "en passant", je veux dire hors de tout contexte spécifique d'apprentissage, par sérendipité souvent, et sans avoir à m'astreindre à la dure discipline de l'étude (que pourtant je vénère au plus haut point, peut-être justement parce que je me sais incapable de m'y plier sans y être de quelque manière obligée) sans laquelle on n’apprend pas...
J’ai retiré de ce cours le point d’appui que j’étais venue y chercher et me suis dit que la première des explorations dont il m’avait donné appétit pourrait être la visite de Picasso.mania. Outre que son caractère temporaire me commandait de me hâter et d’aller là avant même que de me rendre au musée Picasso dont les collections sont permanentes, j’avais été alléchée par les premiers mots de présentation: Cent chefs-d’œuvre de Picasso, dont certains jamais montrés… En ayant aussitôt déduit que c'était là une exposition à ne pas rater, je n’avais pas fait grand cas du petit bout de phrase glissé juste après les Cent chefs-d’œuvre…, indiquant que ceux-là étaient confrontés aux plus grands maîtres de l'art contemporain. J’étais persuadée qu'il ne s'agissait que d'une confrontation incidente, mettant ici ou là en correspondance, par l'accrochage, certaines œuvres de Picasso et leurs citations par quelques artistes des générations suivantes – faisant ainsi écho à cet art de la citation que lui-même, à l'instar de bien d'autres peintres, avait largement pratiqué en rendant de signalés hommages à ceux de ses prédécesseurs qu’il révérait tels Ingres, Manet, Velázquez… Pour dire à quel point m'avait été indifférente cette confrontation annoncée, je n'avais même pas pris le temps de déchiffrer la liste de noms égrenée ensuite, dont quelques-uns demeuraient attachés à des objets dont la vue ne m’avait pas inspiré grande estime.
Quelle n’a pas été ma déception en constatant très vite que la véritable vedette de l’exposition n’était pas Picasso mais… ses héritiers! Significativement, on est accueilli non par une œuvre de Picasso mais par une installation vidéo de dix-huit écrans montrant chacun le portrait en noir et blanc d’un des artistes exposés, portraits qui se colorisent à tour de rôle quand l’artiste filmé prend la parole pour expliquer ce que représente Picasso pour lui… Pour habilement conçue qu’elle ait été, cette installation ne m’a pas retenue longtemps: j’étais venue pour Picasso et, ayant aperçu du coin de l’œil, bien isolé par l’accrochage, l’Autoportrait de 1901.
Manifestement délaissé par les visiteurs, tous agglutinés devant les écrans dont je me détournais, il s’offrait tout entier à mon attention et j’ai profité de ce que pouvais m’en approcher au plus près pour m’y abîmer jusqu’à distinguer, selon l’angle sous lequel j’observais la surface peinte, les traces de pinceau. Voir ce genre de détail est extrêmement émouvant: c’est comme assister au surgissement de la main du peintre, vivante et au travail – quelque chose se met à vibrer dans la toile qui n’est plus tout à fait de l’ordre du visuel et ressemble beaucoup à une présence. Puis, tout d’un coup, j’ai vu, sans qu’elles s’évanouissent alors que je me déplaçais, d’infimes stries partant en faisceau de part et d’autre de l’entrœil – des moustaches de chat voilaient les deux yeux au regard si magnétique! Mirage? Ou réelle trace laissée dans la pâte?
M’arrachant enfin à la quasi hypnose où m’avait plongée ce tableau, j’ai poursuivi ma visite, de plus en plus déçue au fur et à mesure que je traversais les salles, ne voyant de Picasso que des œuvres représentatives d’une toute petite partie de son parcours, en effet confrontées à leurs citations – lesquelles m’ont paru manifester ce que l’art "contemporain" peut avoir de plus consternant dans sa facilité et son absence d’inventivité. Mais il y eut bien pire que l’ordinaire déception. La salle consacrée aux citations de Guernica allait me faire éprouver la plus profonde révulsion… Sur l’un des murs, un assemblage de dépouilles de loup! Des loups naturalisés! Je n’ose songer au nombre de dépouilles qu’il a fallu réunir pour constituer ce rectangle de quelque 3,5 mètres sur 7, censé reprendre les dimensions de la célèbre toile de 1937, ni à la façon dont l’auteur se les est procurées. Non seulement je trouve honteux de ravaler au rang de matériau des cadavres qui n’ont, ainsi, même plus la noblesse que l’on peut trouver, quelque opinion que l’on ait de la chasse, aux trophées, mais s’agissant en outre d’animaux que l’on s’efforce tant bien que mal de protéger et dont plusieurs espèces ont déjà disparu victimes de chasses abusives, cela devient proprement scandaleux. Le titre de la chose: Qui a peur du grand méchant loup? Ô quelle recherche! quel effort de symbolisation! Mais c’est affligeant!!! Plus scandaleux encore: personne ne semble s’indigner… Je risque d’être accusée de sentimentalisme stupide – après tout, ce ne sont que des bêtes… et puis, il est de bon ton aujourd’hui, dans certains "camps" idéologiques, de cracher sur tout ce qui se rattache de près ou de loin à un prétendu "boyscoutisme planétaire" et de vouer aux gémonies les organisations humanitaires – alors pensez donc: se préoccuper de la sauvegarde des animaux, quelle sottise, et de quelle mollesse tripale cela est-il le signe! Tant pis, j’assume. J’assume mon coup de gueule peu ciselé, je persiste, je signe, autant de fois qu’il le faudra. Et quand bien même je consentirais à ne m’en tenir qu’à des considérations plastiques, Qui a peur du grand méchant loup? se caractérisant par une totale absence de dépassement formel et de travail sur la matière, ce ne peut être autrement qualifié que de fumisterie.
Outre l'indicible révulsion causée par Qui a peur du grand méchant loup? qui ne s'amuit pas tandis que le temps passe ‒ et au contraire s'affûte dès lors que je l'évoque ‒ je retire de ma visite une immense déception, dont je dois bien admettre qu'elle est imputable à une colossale faute de lecture de ma part. Maintenant, le vif de ce désappointement s'atténuant, lui, tandis que le temps passe, je me dis qu'en définitive, j'ai simplement commis une erreur d'ordre chronologique et que cette visite, si elle avait été précédée d'une accumulation suffisante de connaissances, m'aurait tout de même dispensé une leçon, la seule au demeurant dont elle puisse être porteuse, à savoir une démonstration des plus instructives de ce qu'aura été la réception de Picasso après sa mort, de ce dont est capable de produire un certain "art contemporain" et, enfin, de ce que l'on entend aujourd'hui par "exposition-événement"...
PICASSO.MANIA
Exposition aux Galeries nationales du Grand Palais jusqu'au 29 février 2016. Plein tarif: 14,00€; tarif réduit: 10,00€.
PS. J’aurais aimé que ce texte soit le dernier déposé avant que s’éteigne 2015. Mais, l’ayant commencé le 31 décembre au matin, c’était chose impossible tant je consacre de temps aux multiples relectures, toujours, évidemment, assorties de repentirs incessants. Tandis que tournaient dans ma tête des phrases éparses que j’assemblais et désassemblais mentalement sans que rien se fixât sinon cette idée récurrente que j’avais manqué le coche du 31, j’entendais, ce vendredi 1er janvier 2016 sur France Culture, s’annoncer , Philippe Domecq qui allait évoquer son livre Trente ans d’art contemporain (Pocket). Il eut à plusieurs reprises de ces propos limpides dont je sentais qu'ils éclairaient comme par magie quantité de ressentis qui se meuvent en moi comme de vagues magmas ‒ une fois de plus, je voyais se nouer d’opportunes synchronicités…
/image%2F0577559%2F20160228%2Fob_d11a2f_choix-1a.jpg)

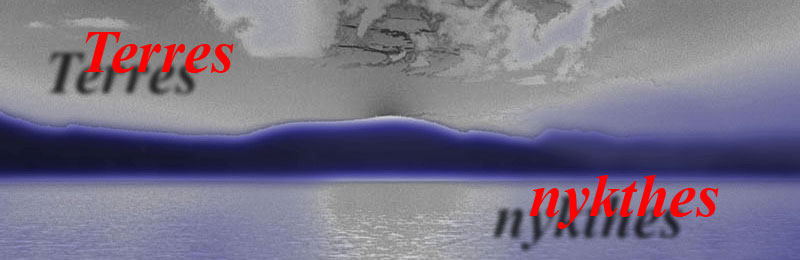


/image%2F0577559%2F20160203%2Fob_4e2e3c_affiche2016-tn.jpg)





/image%2F0577559%2F20160124%2Fob_6de842_stella-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F20160114%2Fob_8c871c_diapason-meteo-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F20160106%2Fob_6a1ddb_le-lent-edifice3-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F20160103%2Fob_4a22c1_autoportrait-bleu-tn.jpg)
/image%2F0577559%2F20151226%2Fob_041c55_compo-vraquee-tn.jpg)


/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)