Je suis rarement l’actualité de près. J'ai continué de m'en
éloigner quand les journaux télévisés – mes principales sources d'information – ont commencé à consacrer une large part de chacune de leurs éditions aux discours, programmes et autres "menus de
campagne" des candidats à la prochaine élection présidentielle. J’ai atteint ce point de lassitude que même les rouges et les verts me déçoivent… passons. Je n’ai donc appris que mardi dernier en
soirée, par un courriel émanant du service "communication" des éditions Actes Sud, le décès d'Hubert Nyssen, survenu le 12 novembre en sa maison du
Paradou. Il avait, ajoute-t-on, souhaité que sa disparition ne soit rendue publique qu'après les obsèques qui ont eu lieu le 15 novembre au matin. La nouvelle ne m’a guère surprise;
je la redoutais depuis que j’avais vu s’interrompre le fil quotidien des Carnets qu’il publiait sur son site, pages dans lesquelles il mentionnait, de plus en plus souvent, diverses souffrances.
Ses notes se sont espacées dès l’automne 2010, la dernière qu’il a écrite date du 24 janvier 2011. J’avais d’abord espéré qu’il s’agissait d’une absence momentanée et que la vigueur finirait par
lui revenir. Mais le silence a persisté; février a passé, puis mars, avril… et les Carnets restaient vierges. "Il doit être bien las, sans doute gravement malade, pour ne plus se délier les
doigts sur le clavier de son ordinateur ", ai-je pensé à maintes reprises.
Aura-t-il seulement pu, avant d’être trop fatigué, sortir de
sa période de quarantaine le roman auquel il travaillait en 2010 et dont ses Carnets portent trace, qu’il avait intitulé L’Orpailleur? Peut-être des publications posthumes me
répondront-elles bientôt…
 Cette disparition me bouleverse bien que je n’aie pas eu
l'honneur de compter parmi ses familiers – collaborateurs, amis, complices, admirateurs, disciples… À titre professionnel je ne l'ai même rencontré qu'une seule fois, le 2 juin 2008: je devais
écrire un article pour la revue belge Le Carnet et les instants qui commémorât le trentième anniversaire de la maison qu'il avait fondée. À cette occasion, il avait accepté de me
recevoir pour me raconter "l'aventure Actes Sud" et m'avait fixé rendez-vous chez lui, dans son mas provençal sis à quelques kilomètres d'Arles. J’ai gardé de cette entrevue un souvenir prégnant.
D’abord parce qu’être ainsi admise à son domicile m’est apparu comme un privilège. Et parce que les heures que j’ai passées à l’écouter dans son Grenier ont été d’une qualité rare – mais, en
quelque dix années de rencontres et d’interviews j’ai connu beaucoup de moments aussi intenses. Celui-ci pourtant a laissé une empreinte d’une profondeur unique, à cause d’une émotion singulière
et inattendue…
Cette disparition me bouleverse bien que je n’aie pas eu
l'honneur de compter parmi ses familiers – collaborateurs, amis, complices, admirateurs, disciples… À titre professionnel je ne l'ai même rencontré qu'une seule fois, le 2 juin 2008: je devais
écrire un article pour la revue belge Le Carnet et les instants qui commémorât le trentième anniversaire de la maison qu'il avait fondée. À cette occasion, il avait accepté de me
recevoir pour me raconter "l'aventure Actes Sud" et m'avait fixé rendez-vous chez lui, dans son mas provençal sis à quelques kilomètres d'Arles. J’ai gardé de cette entrevue un souvenir prégnant.
D’abord parce qu’être ainsi admise à son domicile m’est apparu comme un privilège. Et parce que les heures que j’ai passées à l’écouter dans son Grenier ont été d’une qualité rare – mais, en
quelque dix années de rencontres et d’interviews j’ai connu beaucoup de moments aussi intenses. Celui-ci pourtant a laissé une empreinte d’une profondeur unique, à cause d’une émotion singulière
et inattendue…
Quand, aux alentours de 13 heures, mon interlocuteur s'est avisé qu’il était peut-être temps de clore l’entretien, il pleuvait. Estimant qu’attendre le car pour Arles sous la pluie n’était pas
très agréable, il me proposa de retser déjeuner. Après quoi sa femme me ramènerait en voiture à mon hôtel. Sollicitée, elle accepta tout de suite et voilà que je finissais cette interview
attablée en compagnie d’Hubert Nyssen et de Christine Le Bœuf, bavardant avec eux de choses et d’autres comme feraient de bons amis. Alors que nous nous voyions pour la première fois! J’en étais
tout émue. Et mon trouble s’accrut parce qu’en voyant mes hôtes se sourire et se regarder pendant que nous conversions, j’ai senti vibrer entre eux cette même tendresse qui unissait mes
grands-parents chez qui, enfant, je passais toutes mes vacances. Pour intempestives qu’aient été ces réminiscences elles n’en furent pas moins douces, et je ne remercierai jamais assez juin
d'avoir été si peu estival en cette année 2008…
Avant les retours de souvenirs, il y avait eut des leçons… Au
cours de l’entretien Hubert Nyssen a maintes fois évoqué les conseils qu’il prodiguait à ses collaborateurs ou bien aux jeunes écrivains peu aguerris; telle une abeille butinant, je mémorisai
avec soin tout ce que je pensais devoir m’être utile. Par exemple cette recommandation de ne jamais s’astreindre à lire l’intégralité d’un manuscrit qui rebute: plutôt que d’alimenter son
exaspération en poursuivant une lecture désagréable, mieux vaut tâcher de déterminer pourquoi on est rebuté. Ou bien cet exercice un peu rébarbatif de prime abord mais excellent pour
forger la manière de quiconque prétend "écrire": choisir, chez l’un de ses auteurs préférés, un passage que l’on affectionne puis le recopier à la main et à la plume – "Pas au stylo bille: à la
plume, c’est important!", avait-il martelé – en prenant soin de ne rien omettre, ni ponctuation, ni alinéa. Je me suis amusée, quelques jours plus tard, à recopier, à la main et à la plume ainsi qu’il le préconisait, un passage d'À La Recherche du temps perdu. L’effet a été magique: à chaque mot tracé sur la feuille
de papier je sentais s’ouvrir devant moi un nouvel accès à la phrase proustienne; il me semblait voir saillir des articulations secrètes, souterraines, que la lecture ne m’avait pas révélées. Et,
ô surprise… l’exercice m’a montré un défaut – entre deux points, la très longue phrase était ponctuée de telle sorte qu’à un moment de l’énoncé se faisait attendre un mot, verbe, substantif ou
adjectif je ne sais plus, qui ne surgissait pas. La faille est minuscule; j'ignore s’il faut l’imputer à Proust ou bien à un relecteur inattentif mais je suis convaincue que même une lecture des
plus minutieuses serait demeurée impuissante à mettre au jour cette fissure.
Aujourd’hui encore, je fais mon miel de ces précieux pollens butinés au Grenier. Précieux au point que je me suis crue quasi miraculée, fécondée par eux et capable enfin de commettre un récit
complet, montrable, qui dépassât le stade du brouillon et fût, après quelques mois de travail, susceptible d’attirer son œil de lecteur intransigeant, de lui donner envie de me prodiguer ses
patientes remarques – retour d’Arles je m’imaginais devenir un jour l’élève d'Hubert Nyssen. Il n’en a rien été; je n’ai pu que rédiger l’article prévu, paru dans le numéro 153 du Carnet et
les instants, et préparer une transcription publiée in extenso sur lelitteraire.com (le premier volet
est à ouvrir ici, à partir d'où l'on se dirigera vers les trois autres). Je crois que ces textes lui ont plu ce qui, pour moi, est déjà magnifique.
À la suite de cette rencontre mémorable je me suis mise à lire assidûment ses Carnets, longs paragraphes mêlant événements familiaux, souvenirs, réactions face au monde qui va – ou ne va pas et c’était alors des colères canalisées par une prose ciselée – humeurs météorologiques décrites avec poésie et humour… Par plaisir de jouir de son écriture ailleurs que dans ses romans, mais aussi parce qu’en revenant ainsi virtuellement au Grenier, j’avais l’impression de revivre ce que j’avais éprouvé ce 2 juin 2008. Très souvent ce qu’écrivait Hubert Nyssen me donnait envie de réagir, de lui écrire en retour – mais ces mots qui se pressaient longtemps sur d'improbables brouillons finissaient en général à la corbeille car, à chaque fois, je me disais qu’ils étaient indignes d’être envoyés à un homme qui maniait la langue française avec autant d’exigence et de virtuosité. Quelques courriels lui sont tout de même parvenus, rédigés comme sur la pointe des pieds – et toujours j’ai reçu des réponses, certes brèves mais où, en peu de mots, se tenait blotti le témoignage que j’avais été lue avec attention et bienveillance. Parfois, une seule phrase m’arrivait – elle était aussi vaste que le geste avec lequel on ouvre la porte de sa maison à un ami. Peu à peu, pourtant, mes messages se sont raréfiés: je devinais, dans les pages des carnets de moins en moins remplies, une fatigue croissante, et j’osais d'autant moins lui écrire, craignant d’être importune. Peut-être ne l’aurais-je pas été. Peut-être que… voire que… Mais les choses en sont là: je n’ai pas su entretenir ces liens ténus qui ont couru à travers la Toile – en ai-je seulement mesuré la valeur?
Tout cela est un piètre tissu de mots qui, je le sens bien, n'exprime pas avec la justesse recherchée mon émotion ni la prégnance des leçons que j'ai retenues de lui. Alors j’y ajoute cette image. Une sorte de lueur m’a traversée en la retrouvant quelque part dans mes archives photographiques: ce que j'éprouve ressemble assez à cette obscure rose fanée. Une désolation courbe, pareille à la longue révérence que tire un saule pleureur penché comme pour s'y noyer au-dessus d'une rivière.


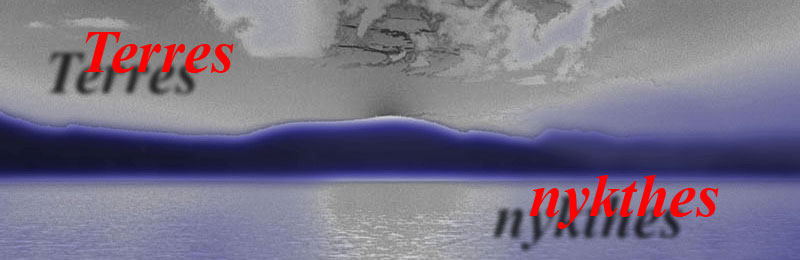


 D
D
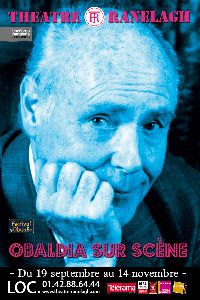
 P
P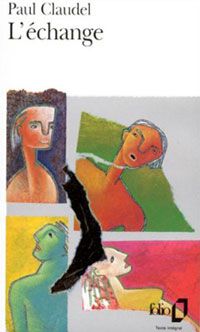 L
L X
X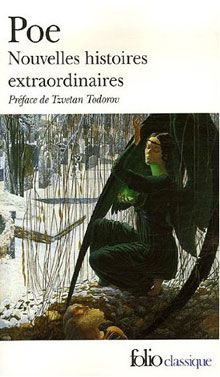 "L
"L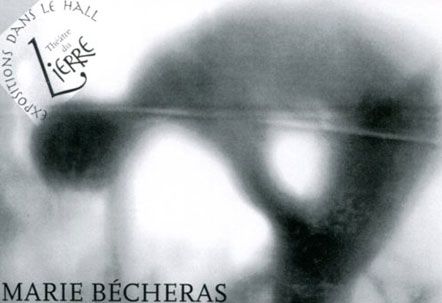



 F
F U
U/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)