
Pour de trop nombreuses mauvaises raisons, l’article est resté là, en souffrance d’achèvement, béant comme la bouche muette de qui ne trouve plus ses mots, depuis le crépuscule de juin – j’avais pourtant bon espoir de déployer les détails des dix-huit spectacles proposés avant l’ouverture de la billetterie, le 1er juillet dernier. Les circonstances en ont décidé autrement, qui me tiennent même éloignée de Sarlat pour la première semaine de festivités. J'avais cependant commencé de méditer sur quelques aspects frappants de la programmation, dont vous n'ignorerez plus rien en consultant cette page. Et je m'apprêtais à effeuiller les soirées l'une après l'autre, au gré des petits "plus" dont Jean-Paul Tribout avait enrichi chacune de ses présentations lorsque nous nous étions rencontrés, le 5 juin – mais mon élan s'est arrêté net et, avant que je reprenne le fil de cet article que je ne voulais pas laissé rompu malgré la quasi-fin du mois de juillet...
Il y a eu Nice. Puis ces trois jours de deuil national, qui s'achèvent en même temps que débute le Festival. Et l'acmé de ces journées en crêpe noir, la minute de silence nationale observée aujourd'hui 18 juillet à midi, qui aura coïncidé avec la fin de la première "Rencontre de Plamon" de cette année.
Déjà, à de petits indices, j'avais bien senti que cette 65e édition portait, profonde, la marque des attentats de novembre 2015, de janvier 2016, et de ces atteintes répétées, à travers le monde, à la dignité humaine. Ainsi Jean-Paul Tribout avait-il, pour la première fois depuis qu'il m'accorde le privilège de l'interview annuelle, souligné lui-même quelques "fils rouges thématiques" liant certains spectacles – par exemple la question de la condition féminine, ou celle des altérophobies de toutes sortes... – tandis que, jusqu'alors, il avait eu plutôt tendance à tempérer sa responsabilité de directeur artistique dans ces "résonances de fond" perçues par les spectateurs et à mettre leur surgissement sur le compte de conjonctions opportunes nées davantage des inévitables compromis entre contraintes et disponibilités que d'une volonté délibérée de rendre voisines certaines pièces...
Et puis ce constat, aussi, qu'il n'y avait pas a priori de spectacle témoignant d'une trop perturbante radicalité dramatique – comme si l'âpreté du monde bouleversé dans lequel nous évoluons en ce moment exigeait que fût laissé aux spectateurs un minimum de "confort théâtral", afin que puisse s'épanouir pleinement une réflexion sur les problèmes essentiels que ne manqueront pas de susciter des spectacles comme Le monde d'hier de Sefan Zweig (19 juillet), Les Pieds tanqués de Philippe Chuyen (21 juillet), Retour à Reims, d'après Didier Eribon (23 juillet), Tabou, de Laurence Février, où l'on entend la plaidoirie de Gisèle Halimi (28 juillet), Et pendant ce temps, Simone veille, de Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon et Trinidad (1er août)... Sans oublier Swing Heil de Romuald Borys (25 juillet), L'Homme dans le plafond, de Timothy Daly (26 juillet) ni Adolf Cohen, de Jean-Loup Horwitz (31 juillet, 2e partie de la Journée des auteurs).
Enveloppant subtilement ces pièces d'une gravité fondamentale que certaines néanmoins drapent d'un voile d'humour, des spectacles pour rire et seulement pour rire – Le Voyage de monsieur Perrichon, d'Eugène Labiche (24 juillet), Un fil à la patte, de Georges Feydeau (3 août) ou pour rêver – L'île sans nom de Johanna Gallard (27 juillet).
Ce jeudi 18 juillet, c'est Philippe Torreton qui ouvre le festival – un comédien dont on connaît la voix puissante et les engagements affirmés, une envergure à lui seul qui, de plus, partage la scène avec Edward Perraud, un percussionniste de très grande renommée. Le spectacle s'intitule... Mec! et a été écrit d'après des textes d'Allain Leprest (1954-2011). Nul doute que ça va claquer...Je m'étais dit, en commençant d'écrire cet article il y a presque un mois, que ça ne manquait pas de sel d'ouvrir un festival où en effet la condition des femmes est bien présente par un spectacle 100% "mec". Mais aujourd'hui cette considération me paraît bien futile.
Pour avoir, par le passé, vu différentes militances s'inviter au Festival avec art, à-propos et force néanmoins – notamment les intermittents, en 2014, qui ont réussi à instruire les spectateurs de leurs difficultés, à les convaincre du bien-fondé de leurs revendications sans jamais interrompre ou perturber une représentation – je sais que le 65e Festival des jeux du théâtre sera un de ces remparts contre la barbarie que seuls peuvent dresser les arts et la culture car ce sont eux, et tout ce qu'ils tiennent sous leur ailes, qui fondent notre humanité. En allant au théâtre, en écoutant de la musique, en contemplant un tableau, en lisant un livre, on est bien plus droit, et debout face à la barbarie qu'en prêtant allégeance à l'un ou l'autre de ces aboyeurs et attiseurs de haine qui, hélas, ne manquent pas de se réveiller à l'odeur du feu et du sang..
Non, aller au spectacle, à Sarlat ou ailleurs, ne relève pas du déni de réalité et ce n'est certes pas reléguer les victimes dans l'arrière-fond de ses pensées: c'est au contraire s'affirmer en tant qu'être humain, compatir dignement en refusant de moutonner dans la haine et l'invective.
Il ne reste pas grand-chose de pertinent, aujourd'hui, dans ce que m'avait inspiré le programme et la couverture du livret imprimé. Pourtant... après avoir longtemps hésité, je laisse en place ces prémices échouées là: il y est question de Shakespeare.
La première surprise que j'ai éprouvée en feuilletant le programme est de constater qu’il n’était pas là… malgré l’illustration, on ne peut plus allusive, qui orne la couverture du fascicule. Alors qu'on commémore le 400e anniversaire de sa disparition, il n’y a pas à l’affiche l’ombre d’une présence shakespearienne, pas même sous la forme d’une (presque) adaptation ou d’un hommage à la manière, par exemple, de l’étonnant Hamlet 60, mis en scène par Philippe Mangenot, que l’on a vu en 2014… Il ne faut voir là nulle intention de se montrer rétif au courant dominant, à "ce-qui-se-fait-partout", non, la raison de cette absence est toute simple; elle est inhérente aux facteurs qui contraignent la programmation sarladaise: «Je n’ai vu aucune pièce de Shakespeare qui aurait été susceptible de venir à Sarlat cette année, et personne ne m’en a signalé que j’aurais pu inviter», m’explique Jean-Paul Tribout. Mais, au fond, sa célébration ne peut-elle tenir dans cette seule manifestation purement graphique? Par le truchement d'une couronne, d'un crâne, d'une nuit étoilée il est immédiatement évoqué en renvoyant à ses œuvres les plus connues; il est ainsi établi en figure tutélaire de tout le festival. Cet habile travail d'illustration, éloquent au premier regard, montre combien William Shakespeare est devenu emblématique du théâtre occidental. Et témoigner aussi simplement de cette imprégnation culturelle, par une sorte de clin d'oeil de connivence, est peut-être, en définitive, une révérence plus profonde adressée au «Grand Will» que de banalement programmer l'une ou l'autre de ses pièces. j'ajouterai, enfin, que cet hommage subtil est en fraternité avec les nombreux spectres qui hantent son œuvre...
Molière en revanche – lui dont je pensais, avant de me replonger dans les anciens programmes qui ont in fine démenti cette conviction, qu’il formait avec Shakespeare un duo d’invités permanents au Festival – est bien présent, à travers deux de ses pièces les plus fameuses (L’École des femmes, le 20 juillet et Les Fourberies de Scapin le 2 août) et, peut-être, les plus jouées, lui dont on ne célèbre rien cette année mais qui n’a nul besoin de commémoration d’aucune sorte pour tenir continument son éminente place dans notre culture.

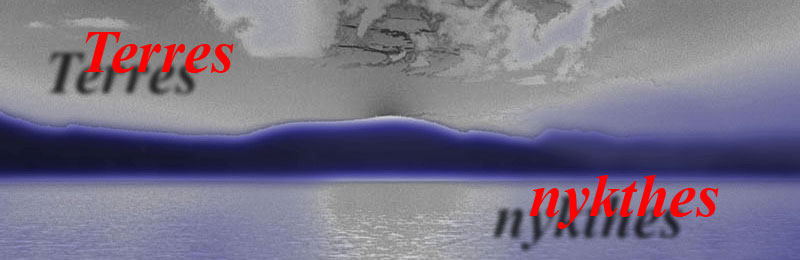







/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)