Lorsqu'un directeur artistique en poste depuis plus de vingt ans expose la programmation d'un festival à une spectatrice qui elle-même suit ledit festival depuis plus de dix ans, la présentation devient vite réticulaire et naît d’un mycélium se déployant en des humus d'autant plus riches et profonds que les années s'accumulent... Le «pitch» est là pour chaque spectacle, tout aussi tiré au cordeau que celui publié dans le programme officiel, puis souvent cela glisse aux souvenirs, aux entrecroisements d'une édition l'autre...

Jeudi 20 juillet, 21 h 45, jardin des Enfeus.
La Peur (d’après la nouvelle de Stefan Zweig). Mise en scène d’Élodie Menant.
Où l’on retrouve Stefan Zweig, dont on avait vu en 2016 une adaptation théâtrale de son autobiographie, traduite en français sous le titre Le Monde d’hier… Et Élodie Menant, déjà venue à Sarlat au service de Zweig, en 2012 avec La Pitié dangereuse où elle incarnait Édith, une jeune fille paraplégique clouée dans un fauteuil roulant. Cette année Élodie Menant a adapté et mis en scène l’une de ses nouvelles, où le rôle principal est confié, ici, à Hélène Degy – dont Jean-Paul souligne qu’elle a été nominée aux Molières comme «Révélation féminine». La Peur est fondée sur une intrigue classique – une femme mariée a un amant et sa liaison est découverte par une autre femme qui entreprend de la soumettre à un chantage. Mais la manipulatrice pourrait bien ne pas être celle que l’on croit… et, aux dires de Jean-Paul, Éodie Menant a traité avec beaucoup de finesse la tension qui s’installe et confinerait presque au suspense hitchcockien…
Nous n’aurons hélas pas le plaisir de pouvoir discuter avec Élodie de son travail car sitôt après avoir joué à Sarlat, elle devra rejoindre Avignon où elle incarne Sarah dans la pièce de Michelle Laurence, Après une si longue nuit.
Vendredi 21 juillet, 21 heures, abbaye Sainte-Claire.
Afrika Mandela, de Jean-Jacques Abel Greneau. Mise en scène de Katy Grandi.
Le titre dit à lui seul ce dont il va être question: l’Afrique du Sud de Nelson Mandela, comment le pays a basculé de l’apartheid à la Nation Arc-en-ciel, comment celui qui a passé vingt-sept ans de sa vie en prison est devenu chef de l’État… Ces grandes pages d’histoire nous sont délivrées par la bouche d’un porte-parole de la mémoire de Mandela, qui se confie à une jeune journaliste. «Mais attention, précise Jean-Paul: ce n’est pas du théâtre documentaire! c’est une véritable œuvre dramatique, avec une très belle écriture, une très belle langue – et d’excellents comédiens.»
Samedi 22 juillet, 21 h 45, jardin des Enfeus.
Le Melon qui… comédie musicale de Jean-Luc Annaix.
«Comme je te l’ai annoncé tout à l’heure, poursuit le directeur artistique, la dominante de cette année est musicale. Jean-Luc Annaix est un grand spécialiste de la comédie musicale et dirige une compagnie basée à Nantes. C’est un habitué de Sarlat: il y a présenté de très beaux spectacles – Et Dokk, donc, s’en vint sur Terre…, Un songe d’une nuit d’été… mais il est vrai que parfois, c’est un peu moins convaincant. [Jean-Paul penserait-il à cette conférence chantée donnée en 2009, dont je garde un assez morne souvenir?] Là cette fable est particulièrement réussie: on nous raconte l’histoire d’un chapeau melon en butte aux menées d’un groupuscule, l’Ordre du Melon, voué à interdire le port du chapeau melon à toute la société. Les artistes entrent en résistance, et partent à la recherche, notamment au paradis, de tous ceux qui ont érigé leur chapeau melon en emblème de la fantaisie, de la poésie: Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Annie Fratellini… C’est une comédie musicale, mais l’on y voit aussi des marionnettes, du théâtre d’objets… »
Dimanche 23 juillet. Journée des auteurs, abbaye Sainte-Claire.
18 heures: Une femme à Berlin. Mise en lecture: Jean-Paul Tribout.
Ce texte, qui se présente sous la forme d’un journal anonyme et a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1954, retrace le quotidien d’une Berlinoise au moment de la chute de Berlin, en 1945. Ce n’est qu’en 2003, à la faveur d’une réédition, que l’on découvrira l’identité de l’auteur. En 1945, au moment de l’occupation de Berlin par les Russes, elle a une trentaine d’années…
Jean-Paul Tribout:
Les civils ne pouvaient pas quitter la ville et l’on estime que quelque cent mille femmes ont été violées, en général plusieurs fois et par plusieurs hommes car, c’est bien connu, en période de guerre la femme est considérée comme un butin. Au fil de son journal, on comprend combien ce qu’elle traverse est différent d’un viol individuel; on la voit aussi mettre en place une stratégie pour se préserver: tâcher de se rapprocher assez d’un officier qui serait à même de la protéger des autres et de lui donner accès à des conditions de vie acceptables – la situation des femmes berlinoises est telle qu’elles forgent un terme spécifique signifiant «coucher pour manger»… C’est, d’une certaine manière, le journal de sa survie que tient cette femme, tout en élargissant son propos à des questionnements plus larges. Par exemple, couchant pour manger, elle se demande si elle peut être considérée comme une prostituée, et de là ce qu’est la prostitution; elle s’interroge, aussi, sur le rapport à la langue: elle se dit notamment qu’il est plus facile de supporter des exactions commises par des hommes dont on ne comprend pas la langue car, ceux-là proférant sons non compris, ils ne peuvent être considérés comme des humains et l’on endure mieux des sévices infligés par des non-humains. Mais elle-même ayant beaucoup voyagé, elle parlait un peu le russe, ce qui bien sûr l’a notablement aidée. J’ai fait de ce journal une petite adaptation destinée à la lecture, dont j’ai confié l’interprétation à Caroline Maillard, la comédienne qui joue dans Vient de paraître. Et si l’accueil du public est bon, j’irai jusqu’à la mise en scène.
19 h 30: apéritif et assiette périgourdine.
21 heures: Adolf Cohen, de Jean-Loup Horwitz.
Adolf Cohen est l’histoire d’un homme qui, né avant la Seconde Guerre mondiale dans une famille juive non religieuse, est baptisé Adolf par des parents alors bien loin de se douter que ce prénom allait bientôt se retrouver fort chargé… Ses parents sont déportés, il est adopté par une famille catholique puis, dans les années 50, il part en Israël où il tombe amoureux d’une jeune musulmane… On voit que le héros est confronté de plein fouet à quelques-uns des bouleversements tragiques qui ont déchiré le xxe siècle mais, malgré tout et bien qu’elle pose des questions identitaires on ne peut plus sensibles, cette pièce reste très humoristique.
L’on aurait dû voir cette pièce l’an passé, également en seconde partie de cette même Journée des auteurs mais il avait fallu la déprogrammer à la dernière minute à cause d’un deuil qui avait de frapper l’auteur. C’est Isabelle de Botton, figurant d’ailleurs dans la distribution d’Adolf Cohen, qui avait assuré le remplacement, en venant interpréter un émouvant seul-en-scène – une évocation «poéticautobiographique» de sa famille et de son parcours où étaient aussi posées des questions identitaires, doublées de considérations quant à la condition féminine distillées à petites touches pleines de tendresse, intitulée alors Moïse, Dalida et moi puis reprise en septembre dernier au théâtre de la Bastille sous un titre autrement plus explicite: La Parisienne d’Alexandrie.
Lundi 24 juillet, 21 h 45, jardin des Enfeus.
L’Affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène Labiche. Mise en scène de Patrick Pelloquet.
Plus trace de gravité ici, avec ce Labiche monté de manière extrêmement dynamique par un Patrick Pelloquet très inspiré par le slapstick américain et qui a mandé un musicien bruiteur pour ponctuer le spectacle de ses créations sonores un peu comme dans un dessin animé et qui demeure sur scène tout au long du spectacle.
Patrick Pelloquet, un habitué de Sarlat et qui, lors de son dernier passage en 2015, nous avait offert un Serment d’Hippocrate signé Louis Calaferte, très drôle mais qui n’était pas de la comédie pure: l’humour y grinçait et il y avait de la satire en texte qui pouvait jaunir le rire. Une pièce qui a été reprise au début de 2017 au Théâtre 14.
Mardi 25 juillet, 21 heures, abbaye Sainte-Claire.
Racine, ou la leçon de Phèdre. Conception, mise en scène et interprétation: Anne Delbée.
Jean-Paul Tribout:
Voilà un spectacle qui ne va probablement pas faire l’unanimité – c’est une manière assez déjantée de fréquenter Racine: en effet, le parti pris de cette pièce est de présenter Racine comme un voisin de palier, que la narratrice côtoie depuis une cinquantaine d’année… Il y a des moments d’une très grande audace qui risquent de bousculer le spectateur mais l’on sent chez Anne Delbée un tel amour de Racine que ça force le respect, et je me suis dit qu’il fallait absolument programmer ce spectacle, en me doutant bien que les discussions à Plamon promettaient d’être vives…
Mercredi 26 juillet, 21 h 45, place de la Liberté.
Ivo Livi, ou le destin d’Yves Montand, d’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos. Mise en scène de Marc Pistolesi. A obtenu le Molière 2017 du meilleur spectacle musical.
Jean-Paul Tribout:
Comme pour Afrika Mandela, le titre dit tout. La vie et la carrière d’Yves Montand sont retracées en flash back à partir de sa mort. À travers le destin individuel du petit immigré italien venu en France avec sa famille pour fuir le fascisme et qui devient, à travers son parcours artistique et ses engagements politiques, l’emblème d’une certaine France, c’est une sorte de destinée achétypique qui se dessine. C’est très réussi sur le plan dramatique, les comédiens chanteurs sont d’excellents interprètes qui, d’ailleurs, ne chantent pas que des chansons de Montand: beaucoup sont des créations originales écrites tout exprès pour le spectacle.
Cette évocation d’Yves Montand me fait aussitôt penser à celle de Brassens qu’avait présentée, en 2012, Michel Arbatz: Chez Jeanne. La Jeunesse de Brassens. L’on y découvrait l’enfance et la trajectoire du chanteur jusqu’à sa première scène parisienne et nous le faisait quitter au seuil de la renommée – une biographie superbement mise en récit dont je conserve un merveilleux souvenir, une «existence scénique» poétique et pleine de grâce doublée d’une façon de chanter délectable qui restituait Brassens sans chercher à l’imiter.
Jeudi 27 juillet, 21 h 45, jardin des Enfeus.
Lettres à Élise, de Jean-François Viot. Mise en scène d’Yves Beaunesne.
À partir de 1917, on sait qu’il a circulé entre le front et l’arrière environ quatre mille lettres par jour. Jean-François Viot, un auteur belge, a puisé dans ce fonds la matière d’une correspondance fictive mais intégrant des passages authentiquement écrits, entre Jean-Martin, un instituteur auvergnat parti à la guerre, et sa femme Élise. Au fil des lettres on perçoit l’évolution des sentiments, la manière dont chacun, du côté où il se trouve, tâche de préserver l’autre – le soldat ne disant pas jusqu’au bout les horreurs du front, l’épouse masquant son inquiétude et ses moments de désespoir.
Pour cette pièce, une commande de la compagnie des Baladins du miroir créée en 2014, Jean-François Viot a obtenu cette même année le prix littéraire du Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles.
Vendredi 28 juillet.
19 heures, jardin des Enfeus
L’Envol de la fourmi, fantaisie funambulesque pour poules et clown de Johanna Gallard. Mise en scène d’Aèll Nodé Langlois (spectacle jeune public).
Jean-Paul Tribout:
Venue pour la première fois l’an passé, Johanna Gallard avait remporté un franc succès avec L’Île sans nom et nous l’avons donc réinvitée. Elle danse toujours sur son fil mais cette fois avec des poules, qu’elle a d’ailleurs eu, paraît-il, bien du mal à dresser pour qu’elles daignent se perche sur le fil…
Que ni les membres du Parti animaliste ni les grands veilleurs de la cause animale point ne s’émeuvent: il est pris grand soin des poules et celles-ci sont, à ce que m’explique Jean-Paul, des quasi-divas dont les conditions d’hébergement ont au préalable été dûment stipulées jusque dans les moindres détails : elles doivent bénéficier d’une surface gazonnée, de cages aux dimensions précises qui seront placées à l’ombre, sous de petits chapiteaux… Osons écrire qu’elles seront traitées… comme coqs en pâte sans quoi elles refusent paraît-il de travailler.
21 h 45, place de la Liberté
Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully. Mise en scène de Raphaël de Angelis.
L’argument est des plus plus convenus: un barbon a pour projet de marier sa fille à un gentilhomme de province morne et ennuyeux, lequel bien sûr n’a pas les faveurs de la belle qui a les yeux tournés vers un autre soupirant, et tout l’enjeu de l’intrigue va consister à faire capoter le mariage, à quoi vont s’employer une suivante et un «homme d’intrigue». Voilà une comédie qui n’est pas réputée être la meilleure de Molière ni la plus subtile tant les ressorts comiques sont jugés grossiers et caricaturaux – c’est une farce, où l’auteur, selon certains critiques, s’avère bien peu regardant quant aux moyens de faire rire (par exemple en recourant à la caricature usée – déjà! - du provincial benêt face aux Parisiens…). Rappelons à toutes fins utiles que Monsieur de Pourceaugnac est une commande, faite à la troupe de Molière pour divertir une assemblée de chasseurs et que le spectacle a dû être monté en une quinzaine de jours…) Mais c’est surtout une comédie-ballet comme on en raffolait à la cour de Louis XIV, emmenée par la brillante musique de Lully…
Raphaël de Angelis était déjà venu à Sarlat en 2013, pareillement au service de Molière, avec un spectacle de tréteaux qu’avait accueilli le jardin du Plantier: La Jalousie du barbouillé et Le Médecin volant, deux pièces courtes donc difficiles à jouer isolément qui étaient réunies en un seul spectacle. Servi par un dispositif scénique simplissime – un drap blanc tendu en fond de scène – et un bel usage des masques dont je devais apprendre qu’il était nourri de deux traditions particulièrement inspirantes pour le metteur en scène ‒ celle, italienne, de la Commedia dell’arte et celle, japonaise, du théâtre nô ‒ le jeu farcesque de comédiens formidablement dynamiques avait suscité force rires et applaudissements chez un public ravi. La comédie-ballet qu’il présente cette année est d’une tout autre ampleur et le metteur en scène convoque, opportunément, les grands moyens: instruments anciens pour interpréter les compositions de Lully, marionnettes et personnages de carnaval pour accompagner les comédiens dans leur jeu. C’est ainsi la place de la Liberté qu’il investit, un espace à la juste mesure de ce qu’il a imaginé – et du large public que ne manquera pas d’attirer le nom de Molière.
Samedi 29 juillet, 21 h 45, jardin des Enfeus.
Chacun sa vérité, de Luigi Pirandello. Mise en scène d’Odile Mallet et Geneviève Brunet.
Signe particulier: les metteuses en scène sont sœurs jumelles, plus qu’octogénaires, toutes deux veuves d’un comédien – Jean Davy pour Odile, Georges Descrières pour Geneviève. «Toutes deux sont beaucoup venues à Sarlat dans les années 60, 70, mais elles continuent à monter des spectacles sans désemparer, et n’hésitent pas à rester sur le plateau jusque très tard dans la nuit quand le réglage des lumières l’exige, rapporte Jean-Paul Tribout avec une pointe d’admiration dans la voix. J’ai vu le spectacle au théâtre du Nord-Ouest, je l’ai franchement apprécié et comme je n’avais encore jamais programmé Pirandello, je me suis décidé cette fois-ci car, mis en scène par ces deux femmes formidables, ça vaut vraiment le détour.»
Cette pièce en trois actes, créée en 1917 et écrite d’après une nouvelle que Pirandello avait publiée en 1915, se situe dans une petite ville italienne, où un nouveau fonctionnaire, M. Ponza, vient d’être nommé. Il arrive avec sa femme et sa belle-mère, et loge cette dernière dans un petit appartement à quelque distance du sien. Très vite la rumeur se répand que M. Ponza séquestre sa femme, et qu’il empêche sa belle-mère de voir sa fille. De son côté, M. Ponza va régulièrement voir sa belle-mère qu’il semble traiter avec beaucoup d’égards, et explique à la ronde qu’elle est folle. Quant à la belle-mère, elle dit à qui veut l’entendre que son gendre est fou… Chacun groupe ainsi autour de lui ses partisans. Mais qui de l’un ou de l’autre dit la vérité?...
Dimanche 30 juillet, 21 h 45, place de la Liberté.
Le Cid, de Pierre Corneille. Mise en scène de Dominique Serron.
Rodrigue, Chimène, don Diègue, ô vieillesse ennemie… sans doute peut-on faire l’économie d’un résumé de cette pièce-phare de notre littérature, dont presque tout le monde a en tête au moins un vers entier. Mais l’on soulignera, parmi les partis pris de mise en scène adoptés par cette compagnie venue de Belgique, L’Infini théâtre, ce choix d’avoir inséré des intermèdes musicaux – tango et flamenco – qui, selon Jean-Paul, s’intègrent parfaitement et ne font nul ombrage aux vers cornéliens. Et puis celui, aussi, de montrer sur le plateau la théâtralité en train de se construire: les costumes, les accessoires sont là, les comédiens au début comme en phase d’échauffement puis qui peu à peu entrent en incarnation.
À ces mots je pense à Romeo et Juliet mis en scène par Vinciane Regattieri (vu en 2013) mais Jean-Paul me ramène, plutôt, vers Hamlet 60 (mis en scène par Philippe Mangenot, vu en 2014) – sans doute l’«être» du spectacle tient-il des deux, et d’autres encore auxquels je ne pense pas faute de les avoir vus? Toujours est-il que ma curiosité est éveillée, et augmentée par la petite visite que j’ai faite sur le site de la compagnie, à la page du Cid…
Lundi 31 juillet, 21 heures, abbaye Sainte-Claire.
Une nuit de Grenade, de François-Henri Soulié. Mise en scène de Jean-Claude Falet.
En partenariat avec le centre culturel de Sarlat.
Cette nuit est celle qui commence au soir du 18 août 1936, dans le bureau du gouverneur franquiste de la place. Face à lui, le compositeur Manuel de Falla (1876-1946) qui, venant d’apprendre l’arrestation de son ami Federico Garcia Lorca et le sachant menacé de mort, a décidé de tout tenter pour le sauver. Non par réelle affinité idéologique mais au nom de la liberté artistique, par essence incompatible avec la dictature. «La confrontation est tendue, le dialogue d’une grande intensité. Et même si nous savons comment cela s’est fini pour le poète, nous n’en sommes pas moins happés par le suspense qui s’instaure», conclut Jean-Paul qui à l’évidence a beaucoup aimé cette pièce dont l’auteur, vivant à Montauban, est un homme de théâtre aux multiples casquettes devenu il y a peu auteur de polar avec un premier roman publié au Masque intitulé Il n’y a pas de passé simple – un roman «très écrit» selon Jean-Paul qui, au moment de notre rencontre, était en train de le lire. Quant à la compagnie qui s’est emparée d’Une nuit à Grenade, la compagnie Label Étoile, elle est basée Mont-de-Marsan.
Mardi 1er août, 21 h 45, jardin des Enfeus.
La Poupée sanglante (d’après le roman de Gaston Leroux). Comédie musicale de Didier Bailly et Éric Chantelauze. Mise en scène d’Éric Chantelauze.
Jean-Paul Tribout:
C’est, au sens propre, une «comédie musicale de poche»: le spectacle a été créé au théâtre de la Huchette, à trois comédiens plus un pianiste. Une telle approche peut surprendre quand on connaît le roman, et si l’on a vu le feuilleton télévisé de la fin des années 70 avec Yolande Folliot, Jean-Paul Zenacker... mais c’est très bien interprété, très bien chanté, et l’on passe vraiment un excellent moment.
Ayant encore en tête toutes fraîches les images de ce feuilleton qui a enchanté mon enfance (ô le magnifique Gabriel...) saurai-je m’en détacher assez pour ne plus voir que ce spectacle?
Mercredi 2 août, 21 heures, abbaye Sainte-Claire.
Le Cas Martin Piche, de Jacques Mougenot. Mise en scène de Hervé Devolder.
Ni Hervé Devolder ni Jacques Mougenot ne sont des «primo-invités» au Festival: le premier était venu en 2011 avec Jupe courte et conséquences, une pièce dont il signait et le texte et la mise en scène, le second avait présenté L’Affaire Dussaert en 2007 dont il était aussi l’interprète puis était revenu en avec son frère François en 2009 pour interpréter La Cigale et la fourmi, une libre appropriation de la fameuse fable de La Fontaine qu’ils avaient cosignée.
Jean-Paul Tribout:
Ce Cas est un spectacle extrêmement amusant qui met en scène deux personnages: un psy confronté à un patient envoyé par sa femme, lasse de le voir s’ennuyer sans cesse. Le seul moment où, manifestement, il ne s’ennuie plus c’est quand il dort – de fait il n’en profite pas vraiment… C’est un divertissement proche du théâtre de l’absurde, très fin et fort bien interprété.
Jeudi 3 août, 21 h 45, Jardin des Enfeus.
Vient de paraître, d’Édouard Bourdet.
En 1927 déjà – date de création de la pièce – le Goncourt était un prix suffisamment fameux pour être satirisé sous les traits d’un «prix Zola», convoité par les grands éditeurs parisiens et, parmi eux, Julien Moscat, que l’on découvre au début de la pièce à quelques heures de son attribution. Fébrile, mais certain de l’obtenir grâce à son auteur vedette, Maréchal – et d’ailleurs se comportant comme si c’était chose faite. Ce n’est que justice: il s’est démené comme un beau diable, a négocié tous azimuts pour s’assurer les voix des «jurés qui comptent». Mais un inconnu survient, humble déposeur de manuscrit qui vient gripper les rouages. Peu importe: un éditeur de l’envergure de Moscat sait réagir vite et parer au plus inattendu de telle manière qu’une situation sur le point de lui échapper vire in fine à son très grand avantage…
Je ne doute pas de revivre ici, agrémenté des variantes inhérentes au plein air, le délectable moment qui avait égayé ma rentrée en octobre dernier au Théâtre 14…
Vendredi 4 août, 21 h 45, jardin du Plantier.
Il était une fois… le Petit Poucet, de Gérard Gélas (d’après le conte de Perrault). Mise en scène d’Emmanuel Besnault.
Jean-Paul Tribout:
Ce n’est pas du tout une adaptation du conte de Perrault: l’auteur entreprend d’imaginer ce qu’est devenu Poucet après que le conte le laisse à son destin. On le retrouve donc vieux, qui a passé toute sa vie à raconter son histoire – celle que tout le monde connaît grâce à Perrault – mais n’en est plus guère capable parce qu’il perd un peu la tête… Alors ce sont ses serviteurs qui raccommodent les trous de mémoire, à l’aide des souvenirs qu’ils ont conservés des innombrables récits sempiternellement recommencés de leur maître. C’est un spectacle musical très bien conçu, parfaitement adapté aux conditions particulières imposées par le jardin du Plantier et véritablement à même de ravir les publics de tous âges.
Samedi 5 août, 21 h 45, jardin des Enfeus.
31, comédie musicale de Gaétan Borg et Stéphane Laporte. Mise en scène de Virginie Lemoine.
L’on prend ici, au son du piano, l’histoire à rebours de quatre amis qui ont l’habitude de se retrouver tous les ans pour fêter ensemble la Saint-Sylvestre. Ce 31 décembre 1999 pourtant, l’ambiance n’est pas formidable… de là s’engage un questionnement sur ce qui fonde l’amitié, l’amour, et qui pousse les quatre amis à revivre rétrospectivement chaque 31 décembre qu’ils ont passé ensemble depuis qu’a débuté leur relation.
J’imagine qu’il y aura certes de l’allégresse mais aussi une bonne dose de nostalgie comme toujours quand on commence à regarder dans le rétroviseur mais, lorsque Jean-Paul conclut en disant «C’est le spectacle le plus gay du Festival», je comprends qu’il y autre chose à comprendre que la simple gaîté suscitée par un spectacle «très joliment chanté et joué». Quelque «question de genre» dans l’air du temps...?
Le temps que dura cette évocation de la toute prochaine édition du festival sarladais, ponctuée d'innombrables souvenirs et échos remontés à fleur de phrases comme autant de bulles chamarrées, j'eus le sentiment étrange d'être blottie au cœur d'une bulle transmonde, dont les parois translucides étaient mille Sarlat chacun à l'heure du Festival tandis qu'à l'extérieur Paris, amuï, pesait de tout son poids de concrétude ici-et-maintenant. Ici et de multiples ailleurs se juxtaposant – mélange troublant ravivé par cette longue et lente phase de mise en écriture et dont la saveur persistante me dit, lancinante, que décidément le Festival toujours m’appelle…


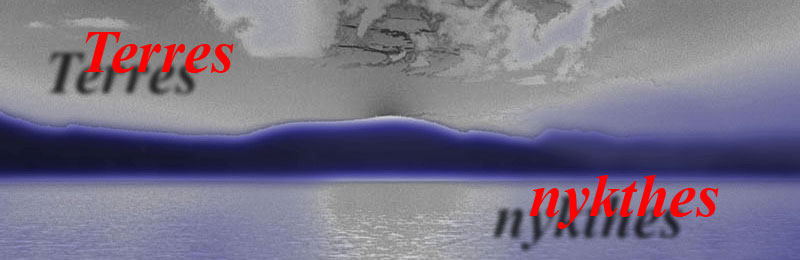










 Cette année encore, grâce à la générosité amicale de Jean-Paul Tribout qui une fois de plus aura consenti à m'accorder de son temps, j'ai pu bénéficier d'une présentation du Festival qui dépasse le cadre du seul programme publié (prêt déjà depuis janvier, et rendu public dès la fin d'avril, que l'on peut bien évidemment découvrir en ligne sur
Cette année encore, grâce à la générosité amicale de Jean-Paul Tribout qui une fois de plus aura consenti à m'accorder de son temps, j'ai pu bénéficier d'une présentation du Festival qui dépasse le cadre du seul programme publié (prêt déjà depuis janvier, et rendu public dès la fin d'avril, que l'on peut bien évidemment découvrir en ligne sur 


/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)