 En ces temps hivernaux – quoique leurs rigueurs semblent marquer le pas – de
petites bouffées estivales seront d’agréables réconforts, surtout venues du Périgord, de Sarlat très exactement, tout en odeur de théâtre qui plus est… Jouons-nous de la ligne du Temps, entre
futur et passé pour, ensuite, mieux rattraper le présent – me revient ici à l’esprit une phrase signée Jean Baudrillard, lue sur un panneau gris qui obture l’une des ouvertures de l’église sainte
Marie, rénovée par Jean Nouvel en 2000 et devenue aujourd’hui un marché couvert :
En ces temps hivernaux – quoique leurs rigueurs semblent marquer le pas – de
petites bouffées estivales seront d’agréables réconforts, surtout venues du Périgord, de Sarlat très exactement, tout en odeur de théâtre qui plus est… Jouons-nous de la ligne du Temps, entre
futur et passé pour, ensuite, mieux rattraper le présent – me revient ici à l’esprit une phrase signée Jean Baudrillard, lue sur un panneau gris qui obture l’une des ouvertures de l’église sainte
Marie, rénovée par Jean Nouvel en 2000 et devenue aujourd’hui un marché couvert :
L’architecture est un mélange de nostalgie et d’anticipation.
Évoquer le
Festival des Jeux du Théâtre relève de ce même mélange, nostalgie parce qu'il y aura toujours à se remémorer des moments exceptionnels, et anticipation parce que la qualité même de ces moments
invite à porter ses pensées au loin, vers l'édition à venir du Festival. Regardant celle de 2009, les dates en sont arrêtées depuis le mois de novembre : elle s’inscrira entre le 18 juillet et le
5 août. Ont même été déterminées les trois soirées pour lesquelles la place de la Liberté devra revêtir son habit de fête – scène et gradins, portiques de projecteurs et dispositifs techniques de
tous ordres : les spectateurs y seront attendus les 22, 24, et 26 juillet. L’on est donc prévenu, avec plusieurs mois d’avance et nul ne saura dire qu’il a été pris au dépourvu !
La nostalgie, et la ressouvenance de moments rares peut s’avérer en prise directe avec l’actualité. Par exemple cette soirée du 21 juillet 2008, place de la liberté, justement, qui est encore si
présente dans ma mémoire… ce soir-là était représentée Sa Majesté des Mouches. Signée Ned Grujic, c’est la première mise en scène française de l’adaptation dramatique que Nigel Williams
fit du roman éponyme de William Golding ; la traduction en français est due à Ahmed Madani. Le texte de Nigel Williams ayant été salué par William Golding, il est le seul qui soit reconnu par les
ayant-droits du prix Nobel de littérature pour être porté à la scène. Le metteur en scène a donc dû renoncer à adapter lui-même ce roman qui l’avait si fort impressionné quand il l’avait lu et
s’en tenir à l’adaptation de Nigel Williams. L’on verra d’ailleurs qu’il l’a légèrement modifiée, aboutissant ainsi à une "adaptation d’adaptation"…
Péril en l’île…
Pour bien comprendre le travail de Ned Grujic un petit retour sur le
roman s’impose. La trame romanesque est simple : pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion qui transportait un groupe d’écoliers anglais, dont l’âge va de 6 à 12 ans, s’écrase sur une île.
Aucun adulte n’a survécu ; les jeunes garçons sont livrés à eux-mêmes. Peu à peu, des hiérarchies s’installent, affinités et inimitiés s’exacerbent, les uns et les autres abandonnent
progressivement les comportements que leur avait inculqués l’éducation. Et puis il s’agit aussi de dompter la peur, la terreur irraisonnée que provoque la présence pressentie d’un Monstre… Tandis
que les vêtements partent en lambeaux la sauvagerie gagne du terrain, aiguisée par la nécessité de chasser pour se nourrir. Un semblant d’organisation sociale se dessine, érodé par une barbarie
rampante qui se manifeste de façon très crue à travers l’attitude que tous ont à l’endroit de Porcinet, un garçon au raisonnement sûr mais que son physique enrobé et sa myopie transforment en
bouc émissaire. Il est de ceux qui, face aux chasseurs, essaient de maintenir quelques règles de conduite "civilisées". Mais elles sont fragiles et les affrontements deviennent féroces, des
meurtres sont commis. Enfin, un navire accoste ; la civilisation et l’autorité reviennent, incarnées par un officier de marine tout de blanc vêtu…
Parmi la foultitude de
questions métaphysiques posées par le roman – il ne s’agit pas de s’aventurer à le scruter au fond de mots : sa richesse symbolique, ses qualités stylistiques, la complexité des problèmes
philosophiques courant sous le récit ouvrent à des développements qui excèdent de beaucoup mes compétences – certaines jaillissent avec plus d’évidence que d’autres. Quelle est la fonction des
règles, des codes dans une communauté humaine ? Quel est le sens du comportement (soumission, obéissance ou rébellion) adopté vis-à-vis d’un chef ? Qu’est-ce que la démocratie ? La "civilisation"
? Que valent les signes (uniforme, accessoires vestimentaires, hygiène corporelle…) par lesquels on la reconnaît ? Qu’est-ce que la bestialité, l’état de nature ? Enfin, dans quelle mesure des
conditions de survie en milieu sauvage effacent-elles les couches de civilisation que la culture et la vie en société déposent en chacun ? Celles-ci ne sont-elles qu'un vernis vite dissous par
une jungle hostile ou bien y a-t-il des tabous, des interdits culturels plus profonds qui résistent à tout?
À l’instar des meilleures
œuvres littéraires, le roman ne répond à aucune: il les contient en filigrane dans sa trame et se borne à mettre en lumière les dilemmes de plus en plus aigus auxquels vont être soumis les
individus, les très progressives inflexions que vont connaître, au fil du récit, les comportements des protagonistes et les subtils changements de géométrie qui, de là, affectent les rapports de
force entre les individus et entre les groupes.
Mais le roman est une monstration, pas une démonstration scientifique; d'ailleurs, la fin du texte, tout auréolée de la blancheur immaculée de l’uniforme de l’officier de marine, a
presque une dimension surnaturelle. Dépourvu d'avant-récit – l'événement initial, le crash de l'avion, est relégué dans de vagues limbes allusifs à la manière de ces Grandes Catastrophes flottant
à titre de souvenir collectif dans les romans d'anticipation – le texte ainsi clôturé prend une tonalité quasi fabuleuse, mythologique, dont la résonance s’entend dans les références littéraires
posées telles de rassurantes balises par les personnages quand ils réalisent qu'ils sont sur une île : toutes appartiennent aux chefs-d’œuvre les plus universels de la littérature de l’imaginaire
et de l’aventure, Robinson Crusoë, Les Robinsons suisses, L'Ile au trésor.
Des pages aux
planches…
Adapter un roman pour la scène c’est, par définition, couper, abréger, souvent araser. De fait, l’adaptation de Nigel Williams – dont on ne juge ici qu’à
travers la traduction d’Ahmed Madani – rend assez abrupts les changements d'attitude des personnages et sabre tous les riches développements que contient le roman à propos de la démocratie ou du
rapport au chef. L'on pourrait arguer que l'adaptation se focalise davantage sur l'évolution des caractères individuels induits par les inflexions relationnelles intervenant au sein des groupes
que sur les questions d'organisation sociale et leurs implications métaphysiques. Mais même à cet égard, le texte théâtral paraît superficiel, par trop simplifié.
On saura donc gré à Ned
Grujic, quoique contraint, comme on l’a dit, de s’en tenir à la traduction du texte de Nigel Williams, d’avoir réussi à réintroduire dans sa mise en scène quantité de nuances – enrichissements
auxquels l’interprétation des comédiens, époustouflante, achève de donner relief et force – alors même qu’il a, dit-il, opéré quelques coupes sans lesquelles le spectacle aurait vraisemblablement
duré une demi-heure de plus. La modification peut-être la plus significative concerne le surnom dont est affublé le jeune myope : "Piggy" dans le texte original, il devient Porcinet dans
le roman traduit par Lola Tranec, et Cochonou dans l’adaptation traduite par Ahmed Madani… Estimant trop prononcée la connotation alimentaire de Cochonou pour des spectateurs français, Ned Grujic
a préféré conserver Porcinet, plus fin et mieux ancré dans l’enfance puisqu’un des personnages de Winnie l’ourson s’appelle ainsi en français. Quelques "Cochonou" cependant fusent, quand les
apostrophes deviennent cruelles et méchantes – apparaît de la sorte une gradation dont le texte est exempt. Sans trop vouloir distinguer parmi les comédiens – qui tous ont offert une prestation
scénique d’autant plus remarquable que leur jeu est souvent aux confins de l’acrobatie… – j’adresse un salut particulier à Alexandre Letondeur, qui donne corps à Porcinet : par sa seule gestuelle
et sa façon de restituer les embarras d'élocution du personnage, il parvient à faire exister la corpulence et la maladresse de Porcinet alors qu'il est lui-même d'une sveltesse
n’ayant rien à envier à celle de ses camarades, plus mobiles et quasi acrobates.

La scénographie, d’une grande
complexité, ajoute beaucoup à la palette des nuances ; à partir d’un décor à l’aspect épuré mais aux implications symboliques très riches – la structure de bois en cercle ouvert, élaborée en
référence au terrain de jeu; bac à sable ou bassin de jardin public, se présente comme une hybridation entre le mur d’escalade et la rampe de skate board, évoquant par ses jeux de courbes à la
fois le cockpit de l’avion, la vague et, de manière plus allusive, le corps féminin et le ventre maternel – elle présentifie d’une façon saisissante les différents lieux dramatiques dans leur
diversité et les déplacements. Enfin, de savants jeux de lumière installent des moments de jour et de nuit aux chatoiements d’une luxuriance pareille à celle dont William Golding a, dans son
roman, paré les crépuscules.
Sans avoir pu adapter à son gré un roman qui, dit-il, l’a profondément impressionné, Ned Grujic a brillamment surmonté la
contrainte et réussi une mise en scène éclatante, riche de nuances, servie par des comédiens au jeu juste et intense qui, de plus, se montrent d’étonnants acrobates.
La montée de la barbarie se trouve montrée là dans toute sa crudité, effrayante – un peu comme si l’on voyait, mis à nu, les fondements élémentaires des guerres et conflits qui embrasent le monde
depuis la nuit des temps ; une manière d’écorché de la vaste humanité…
Sa Majesté des Mouches, mise en scène de Ned Grujic. Jusqu'au 15 février 2009 au Théâtre 13 - 103 boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS
 Anne-Marie Mitchell, L’Humain me fatigue, voyage avec mon chat, éditions Les Transbordeurs (97 Traverse de la Gouffonne - 13009
Marseille), septembre 2007, 147 p. - 13,00 €.
Anne-Marie Mitchell, L’Humain me fatigue, voyage avec mon chat, éditions Les Transbordeurs (97 Traverse de la Gouffonne - 13009
Marseille), septembre 2007, 147 p. - 13,00 €.

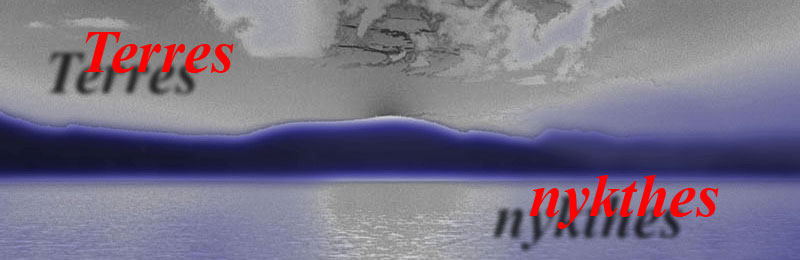


 J
J J
J P
P D
D


 E
E



/idata%2F2501025%2FLa-rose-de-Meyraguet%2F6.jpg)
/idata%2F2501025%2FAtelier-dessin-musique%2Fcontrebasse1.jpg)
/idata%2F2501025%2FAvec-Marie-Annick-2%2FG.jpg)
/idata%2F2501025%2FBouches-a-feu%2FPatrimoine-7_5.jpg)
/idata%2F2501025%2FCouleur-cafe%2Fapercu-general-le-collecteur-de-pellicule.jpg)
/idata%2F2501025%2FCoskun%2FExpo-Renard-pale_livre2.jpg)